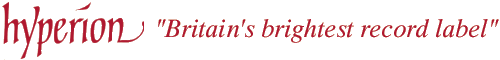
Welcome to Hyperion Records, an independent British classical label devoted to presenting high-quality recordings of music of all styles and from all periods from the twelfth century to the twenty-first.
Hyperion offers both CDs, and downloads in a number of formats. The site is also available in several languages.
Please use the dropdown buttons to set your preferred options, or use the checkbox to accept the defaults.


'Les Six' was the appellation given to a group of young French composers circa 1920 who briefly worked together as a counter-offensive to the excesses and giganticism of 'late-Romantics' typified by such composers as Mahler and Schoenberg. But the movement didn't last long and each of the 'six' soon went his (or in one case her) own way. The most familiar names of the six today are Poulenc, Honegger, Milhaud and Auric. Also, to some extent, Germaine Tailleferre. The least remembered member of the group is undoubtedly Louis Durey, who died as recently as 1979. Like Britain's Rutland Boughton and Alan Bush, his career was seriously hampered because of his well-publicised political beliefs. He was a communist, even setting to music some of the writings of Ho Chi Minh.
Durey's turn in our French Song Edition has now come, and this disc assembles a programme of his virtually unknown songs including settings of Apollinaire's Bestiaire, the only composer to set all thirty of them.

Louis Durey, the silent Durey, is the incarnation of modesty and nobility. (Francis Poulenc, from Entretiens avec Claude Rostand)
Of the six composers grouped together in an article by the critic Henri Collet in January 1920 and nicknamed ‘Les Six’, Francis Poulenc is now surely the best known – his music is constantly heard in recital and on disc; Darius Milhaud is perceived as a substantial composer with a vast work-list encompassing many musical forms; the orchestral and choral music of Arthur Honegger is still to be found on concert programmes with fair regularity; the film music of Georges Auric keeps the composer’s reputation alive, albeit not in the way he might have wished; Germaine Tailleferre, largely unknown (and unpublished) even in her own time, has benefited from the lively interest in music by women composers that has been a feature of musicological research in recent years.
With five names accounted for, this leaves Louis Durey. He has always seemed to be the ‘orphan’ of ‘Les Six’, although he was a proud and self-sufficient man and would have detested being the subject of pity. After those heady days of being part of a youthful phenomenon, briefly a member of a musical ‘jeunesse dorée’ with which he had little in common in terms of temperament, he continued stoically with his career, never feeling the need to belong to the musical establishment, and remaining unflinchingly true to his left-wing ideals. Durey took no part in that collaborative work Les Mariés de la Tour Eiffel of 1921 – a decision which was a source of huge annoyance to Jean Cocteau. Although the date of the group’s dispersion is officially 1924, it is clear that ‘Les Six’ no longer existed as an entity as early as 1921 – if indeed it ever had.
Although Durey was a Parisian by birth, most of his music was performed outside the capital, and he came to detest the ‘smart’ society world in which most of his creative contemporaries moved. His ambition was to write music in a language that was non-elitist; most of his creative life he was a member, and later Secretary, of the Fédération Musicale Populaire, something of a French equivalent of The Workers’ Music Association to which that still underestimated English composer Alan Bush dedicated much of his creative life. Like Bush, Durey subscribed to the tenets of the Prague Manifesto of 1948 which called upon progressive musicians to democratise their compositions by abandoning individualism and writing music derived from folksong.
Such unfashionable communist sympathies were never likely to advance a composer’s career. After his break with Cocteau, Durey shrugged off the indifference of the glamorous world of the pre-war salon; then he faced the dangers of membership of the Resistance during the years of the Nazi occupation when he wrote anti-Fascist songs. Finally, the conditions of the Cold War and his hard-line political stance were hardly conducive to commissions and performances. He seems to have been impervious to all setbacks. The fame, chic and influence of French left-wing authors like Sartre seem not to have encompassed musicians like Durey. He became music critic of the Paris communist newspaper L’Humanité in 1950, but the melodically memorable music of Joseph Kosma turns out to have provided a more enduring musical portrait of the Parisian literary Left of the 1950s and ’60s.
Louis Durey was born on 27 May 1888. He came from an artistic background of sorts, a down-to-earth milieu where aesthetic sensibility was combined with pride in skilled labour and the discipline of factory production. His father was proprietor of a firm that manufactured print type, and his brother René became a painter who also played some part in the idea of combining music and painting in the early days of the concerts given by the ‘Nouveaux jeunes’. Durey was a late developer who decided on a musical career only at the age of nineteen as a result of hearing a performance of Debussy’s Pelléas et Mélisande (he already knew some of the Wagner operas). Debussy remained the composer’s lifelong inspiration despite the attraction he felt to such figures as Schoenberg, Satie, Ravel and Stravinsky. Years later he confessed that Debussy’s ‘suprême élégance’, his ‘tendre et pénétrante poésie’ had always been his surest musical guide. As a composer and orchestrator Durey was largely self-taught, but an important mentor in the study of harmony and counterpoint between 1910 and 1914 was Léon St Requier, a choral conductor from the Schola Cantorum. It is scarcely surprising therefore that, right from the beginning, choral music is of great importance in Durey’s output. His Opus 1 (1914) was two Chœurs a cappella to texts of Henri de Régnier and Charles d’Orléans (both poets of whom Debussy would have heartily approved – and one must remember that the great composer was still alive at this point, a remote presence hovering invisibly in the background of Durey’s work). The link with the Schola Cantorum no doubt led the young composer to the circle of Erik Satie whose famous eccentricities were later explained by Durey as ‘un caprice de la nature’. An array of small song-cycles quickly followed: settings of Paul Verlaine (Op 2), Francis Jammes (Op 3) and Rabindranath Tagore in the translation of André Gide (L’offrande lyrique, Op 4), the latter work influenced by his brief dalliance with the atonality of Arnold Schoenberg.
Durey was mobilised in August 1915 but continued to write other-worldly vocal music in defiance of the dark and miserable mood of the times. The Gide cycle Le Voyage d’Urien dates from this time, as do the choral settings of Saint-John Perse (Eloges – an important precursor to the Perse cycle Images à Crusoé). The first work to make a stir in the musical world, however, was for piano duet – a piece titled Carillons, inspired by a visit to the north of Italy, and dedicated to Satie. The work was first performed by Georges Auric and Juliette Meerovitch in June 1917. If at first this piece seemed to have been composed in the shadow of Stravinsky’s Le Sacre du Printemps, Durey himself later avowed that this evocation of bells sounding in different tonalities was much more influenced by Debussy’s Cloches à travers les feuilles. This Carillon, and its sequel Neige, attracted the interest of Maurice Ravel at a concert in early 1918. (The other composers on the programme were Tailleferre, Honegger, Auric and Poulenc – whose Rapsodie nègre received its first performance on that occasion.) Ravel seems to have been less impressed with Poulenc; he introduced himself to Durey and immediately recommended him to his publisher, Jacques Durand. In a letter to the younger composer of the utmost friendliness and tact, Ravel also offered Durey any help in matters of orchestration that he might think necessary. Durey never forgot the kindness of Ravel; indeed this was indirectly to be the cause of his break with Cocteau and Les Six. At this time Durey also earned the approbation of one of the most fastidious of French composers, Albert Roussel, who wrote a very favourable review in The Chesterian of October 1919: works singled out for praise in this article included Le Bestiaire, the Trois Poèmes de Pétrone and the Images à Crusoé.
Durey had originally belonged to the circle of young men around Erik Satie; indeed he had been dubbed one of his ‘Nouveaux jeunes’ (together with Auric and Honegger). Durey’s new friendship with Ravel was probably one reason for Satie’s break with the group in November 1918 opening the way for a new mentor and propagandist – Jean Cocteau. All the vocal works to be heard on this disc date from this exceptionally creative period in Durey’s life, that is to say 1918/19, before the so-called ‘christening’ of Les Six in early 1920. Of course Durey was eleven years older than Poulenc (he was the oldest member of Les Six – older even than Cocteau) so it is hardly surprising that when the younger composer was piecing together his first masterpiece to texts from Apollinaire’s Le Bestiaire, Durey was already a practised song-composer with many of his most important vocal works already behind him, and an impressive array of poet-collaborators. We have mentioned Saint-John Perse (an important literary figure otherwise all but ignored by composers); Durey was also attracted to translations from the classics (Epigrammes de Théocrite, Trois Poèmes de Pétrone) as well as the eighteenth-century poet Evariste Parny (Inscriptions sur un Oranger) whom Ravel was later to set in his Chansons madécasses. His shared enthusiasm with Poulenc for the texts of Le Bestiaire seems to have been a coincidence. (In the same way Debussy and Ravel, five years earlier, had alighted on the poems of Mallarmé almost at the same time.) When Poulenc heard that Durey had also set Le Bestiaire poems – and every single one of the animal poems! – he dedicated his six settings from the same textual source to Durey. Indeed, the words ‘à Louis Durey’ at the head of Poulenc’s score will have been the first and only sight of this composer’s name for many a young singer and accompanist.
In the beginning, Durey was the moving spirit, one might almost say the secretary, of the ‘Nouveaux Jeunes’. Jean Cocteau had written an article (one of several) about this group of composers in Paris-Midi in July 1919. It was Durey who sent a copy of the article to his colleague Milhaud and asked him to contribute a piano piece to a recueil to be published by Demets bringing together the names of the six composers who were soon to be dubbed ‘Les Six’. His own contribution to this collection was a Romance sans paroles which was written as a homage to Mendelssohn. (Even this unfashionable choice of role model might have sounded warning bells about Durey’s future with the group.) In the summer of 1919 Durey and his brother Pierre went on holiday with Cocteau in the Basque region of the south of France. The musical outcome of this period were the three Chansons basques where the composer’s first encounter with the poetry of the ultra-Parisian Cocteau is combined with a feeling for the more earthy idiom of folk music. Another Cocteau work by Durey, Printemps au fond de la mer – a rather laconic piece for voice and ten wind instruments which evokes an extraordinary deep-sea landscape – received its first performance on 31 January 1920 by the indefatigable Jane Bathori, the soprano who played such a large role in the propagation of new music in this period.
At first all seemed harmonious enough between Cocteau and Durey. Cocteau reviewed the simultaneous appearance of the two Bestiaire cycles by Poulenc and Durey with appropriate animal imagery: ‘Where Poulenc leaps like an ungainly young dog, Durey steps delicately like a hind. Both of them are natural’ [Là où Poulenc saute avec des pattes de jeune chien, Durey pose délicatement ses pieds de biche. L’un et l’autre naturels.] Such publicity, and the protection of a poet who was a master of public relations, might have been thought to be something invaluable for an emerging composer. But Durey had decided that he did not like Cocteau very much. He wrote to Milhaud: ‘Jean is an exquisite man with whom it is difficult to be shocked, yet his incredibly light mind and pretend baby-games annoy me often’. [Jean est un être exquis, contre qui il est dur de se choquer, mais il a une légèreté d’esprit inconcevable et il joue au bébé avec une feinte ingénuité qui me gêne bien souvent.]. This is about as damning a verdict on the narcissistic and superficial side of Cocteau’s personality as exists from a member of his own circle. Composers like Poulenc and Milhaud were capable of seeing past the irritations of the poet’s self-absorption, and both managed to conserve friendships which lasted for more than forty years. But Durey was also profoundly out of sympathy with some of Cocteau’s aesthetical dicta. In one of his articles (May 1920) in Le Coq – a tract that was the official organ of Les Six – Cocteau repeated one of Satie’s choicely savage pronouncements: ‘Ravel refuse la Légion d’honneur mais toute sa musique l’accepte’. (‘Ravel refuses the Légion d’honneur but all his music accepts it.’) Satie and Ravel had their own troubled history, but it offended Durey that Cocteau had climbed on the same bandwagon. This gratuitous discourtesy to a great French composer (especially from someone who was, in his own way, a far greater snob and socialite than Ravel ever was) enraged Durey to the point that he thought it necessary to distance himself permanently from Les Six. He withdrew from plans to write a Valse des dépêchés for Les Mariés de la tour Eiffel – a work which Cocteau had assumed would represent the definitive collaboration of the group.
Milhaud did his best to persuade Durey to change his mind, begging his friend to avoid what he called ‘une politique d’agression’ and asking him to respect what Poulenc called the ‘unité variée’ of the group: ‘You like Ravel, Arthur [Honegger] likes [Florent] Schmitt. I like [Albéric] Magnard, Francis likes [Albert] Roussel, Tailleferre everybody and Auric nobody. Liberty for all. All the better that our tastes diverge, All the more reason to be more united’. Another letter in which Cocteau attempted to persuade Durey to relent has a note of petulance and a clear sense of personal betrayal. Nothing availed, and Durey’s withdrawal from the Mariés project signalled the end of Les Six as a group. In his Plain-Chant of 1923 Cocteau included a poem about how he had fostered ‘his’ composers:
Auric, Milhaud, Poulenc, Tailleferre, Honegger
J’ai mis votre bouquet dans l’eau du même vase,
Et vous ai chèrement tortillés par la base,
Tous libres de choisir votre chemin en l’air.
Auric, Milhaud, Poulenc, Tailleferre, Honegger
I have put your bouquet in the waters of the same vase
And fondly twisted you by the stem
All of you free to choose your way in the air beyond.
Durey’s absence from Cocteau’s proprietorial line-up is deafening. From then on it was a question of slightly woebegone group photographs on anniversary occasions; in pictures from 1931 and 1951 Durey’s presence is awkward: he is placed either in the background, or as far away as possible from Cocteau who dominates the assembly. Durey seems to have enjoyed the musical collaboration of his colleagues (the correspondence from 1959 with Poulenc quoted at the end of this article is a testament to this), but he felt the group’s musical activities had been hijacked by the self-serving Cocteau as a chic means to épater les bourgeois in a way that was facile and dishonest.
Durey now found himself in a self-imposed artistic isolation which was to last more or less for the rest of his life apart from the support he received from artists of a similar political persuasion. As he told his friend Milhaud, he believed in the birth of a new romanticism which was absolutely at odds with the aesthetic of Les Six. One can hear this desire to find a new romantic voice in his desire to set two poems of Heine – Deux Lieder Romantiques; the text of the second is forever associated with Schumann. (In his own way, Poulenc was also destined to write more lyrical music in the thirties than that of the twenties: his postlude to Tel jour, telle nuit is a covert tribute to Schumann’s Dichterliebe.) For the decade following the break with Cocteau, Durey withdrew to the south of France where he had a house in St Tropez. Here he worked in absolute calm on his Cantate de la Prison and on his only opera, L’Occasion, which took some years to compose. This was inspired by a play by Mérimée with a controversial subject (two young girls in a convent are tragically in love with the same priest) which made it impossible to stage; it received its first concert performance in 1974. That Durey should have lavished such a huge amount of work on a subject which any streetwise composer would know had no future in a French opera house shows either iron integrity or a blinkered view of the practicalities of life, or perhaps both.
The composer married Anne Grangeon in 1929 and moved back to Paris in 1930. In this period he composed chamber music (his third string quartet) and his Dix Inventions for piano. He also wrote incidental music for L’Intruse, a play by Maeterlinck. In the mid-thirties he joined the Communist Party and became active in the newly formed Féderation Musicale Populaire. As fellow-members of this organisation he found composer colleagues on the Left who were also far removed from the social world of Les Six – Charles Koechlin, and his old admirer Albert Roussel. Between 1937 and 1944 he had little time to compose, so involved was he in musicological tasks. He began to reconstruct the forgotten music of François-Joseph Gossec (1734-1829) who had attempted to compose ‘music of the people’ during the turbulent years of the French Revolution in a way that seemed exemplary for a man of Durey’s beliefs. Research into the madrigals of Marenzio and the vocal music of Josquin des Prés and Janequin showed Durey’s on-going commitment to choral music, a form which he came to believe was the most effective vehicle for music of political persuasion. In due course, particularly in the 1950s and early ’60s, he was to write many choral settings (including harmonisations of folksongs from all over France) in a desire to provide amateurs with accessible music which could be learned easily – music for the people.
During the German occupation Durey was one of the musicians who worked as part of Front National des Musiciens, an arm of the Resistance from which many a famous musical name was notably absent. Fellow militants were Désormière, Manuel Rosenthal and Roland-Manuel. After the war Durey began to compose again, and his continuing political commitment is evident from his choice of texts for his vocal music: Lorca, Langston Hughes and Ho Chi Minh, and many another minor poet associated with the class struggle. He became ever more certain that it was the obligation of the artist to embrace hard-line communism. Sadly the music from this period has neither the immediate catchy tunefulness of a Kosma, nor the sense of mystery and poetry which had pervaded his own earlier work. In the late 1950s and early ’60’s there was a re-flowering of Durey’s work where there is some sign of his re-connecting with that special, and gently exotic, voice which makes his music so easily distinguishable from his fellow members of Les Six. In the light of recent political developments one would say that these were years wasted in pursuit of the artistic ideals of Russian and Chinese communism – although it is almost certain that Durey himself, were he still alive – he died on 5 July 1979 – would merely see it all, without regrets, as part of a long and continuing struggle. His work on Vietnamese themes in the sixties, born of anger and outrage against an unjust war, seemed the outpouring of a lone musical voice, but it is a voice that in retrospect seems brave and necessary.
In 1920 Poulenc wrote to Durey telling him about his fifth Impromptu which he believed his friend would like because it was ‘excessivement triste et grave’. This tells us something about even the younger Durey’s reputation for seriousness among his colleagues, although a letter of 1933 from Durey to Poulenc admires Ninon Vallin’s performance of Poulenc’s light-hearted Airs chantés. There is a very touching last exchange of letters between Durey and his old friend in 1959. Poulenc had been sent a batch of reviews of the two ten-inch LPs of his songs recorded by him and Pierre Bernac on the Véga label (perhaps the finest collection of recordings ever made by the duo). Among these cuttings he found an article by Durey who had written that Poulenc’s mélodies were now classics and took their place besides those of Fauré and Debussy. This prompted Poulenc to write a short but affectionate letter to Durey thanking him for the praise, aware as he was that such approbation did not come easily from an man of such integrity. Bernac, soon to retire, had just sung Le Bestiaire for the last time and Poulenc’s mind went back to a time in 1918 or 1919 at Durey’s apartment in the 14th arrondissement when both cycles had been performed: ‘I suddenly saw again rue Boissonade. Happy times! I embrace you tenderly.’ [J’ai revu tout à coup la rue Boissonade. Heureux temps! Je t’embrasse tendrement.]
Durey’s reply is worth quoting at greater length because in it we can hear the true voice of the good friend and refined artist, the struggle of whose career (not least with attempting to organise musical links behind the Iron Curtain) was so different from Poulenc’s own:
Saint-Tropez, 20 June 1959
Bien cher Francis,
Your letter has just reached me here and it has, as you can imagine, given me very great pleasure. You say that ‘the older you get, the more you like to think back on our youth’. This is the surest way of refusing to grow old; and being as I am 11 years your senior, I can assure you that the prescription is one of the best. I have the rare good fortune of not yet feeling too greatly the ravages of time; and the youthfulness I imagine I still possess sustains itself at the source of our friendship – an extraordinary friendship that will always stand as an example to those younger than ourselves. It has lasted for 40 years, dear Francis – and although that famous article by Henri Collet dates from early January 1920, it merely sanctioned something that was already in existence, that had been growing during the preceding months – notably through the concerts at the Vieux-Colombier organized by our admirable Jane [Bathori].
I think it would be a good thing if we could have a reunion one day, in private, during the coming autumn, to celebrate this 40-year friendship and our indestructible ties of fellowship. Although, alas, Arthur [Honegger] has already left us, his memory is always with us, and this can only bind us together even more strongly. In any event, it would be a great joy to me if we could meet again before long.
I did think of sending you a copy of the article I wrote for Europe about your songs; only my usual negligence, which led me to procrastinate day after day, has prevented me from doing so. Listening to the two records, I was really very struck by their unity and by the distinctive quality of the works, which have become true classics. Since then I have also had the opportunity of speaking about your very successful Sonata for flute and your Trio.
Unfortunately, my trip to Poland did not come off. The Ministry for Foreign Affairs had led me to expect a subsidy for the trip but at the very last minute they refused it. The Concert des Six which I had prepared took place in spite of this: it consisted of the second Sonata for violin by Darius, the Chansons françaises by Germaine, the Apollinaire settings by Arthur, the Trio for reeds by Georges, your Sonata for flute, and my Chœurs de Métiers. As for the talk 1 was due to give, it was published in a Polish literary review. I was very disappointed but perhaps there will be another opportunity some time.
In connection with Le Bestiaire, you mention the rue Boissonade. I will not be staying there much longer. We have in fact been expropriated by the Welfare Board, which adjoins our property. Our house is going to be demolished and will be replaced by the morgue for the hospitals that are being built behind us. Too many memories are attached to the place for me not to be devastated by all this. Consequently, I am more than delighted with our house in St Tropez; the spot where we are is sufficiently secluded – it is two kilometres away from the town – to be free from noise and disturbance, even in mid-summer. …
[…]
I hope that it will soon be possible for us to see each other again. My affection for you remains as much as ever alive, immediate and necessary.
I embrace you.
Louis
[Translation by Sidney Buckland from Francis Poulenc: ‘Echo and Source’]
It seems clear from listening to the vocal music of Durey that his membership of Les Six was more an accident than anything else – a result of his going along with a trend after the break with Satie in 1918, and because of his friendship and affection for his young fellow-musicians of the time. It was not a movement that could offer him a great deal aesthetically; that he was already thirty by 1918 (and not as interested in merry, shocking pranks as he might have been in his twenties) is surely part of the anomaly. The music on this disc is thus not presented chronologically; to arrive at the Cocteau settings at the end of a programme would be to misrepresent the path of Durey’s development as a writer of mélodies which tapered away towards the 1920s rather than moving forward in a crescendo of expressivity. Instead, our disc moves rather in the spirit of Apollinaire’s L’Écrevisse – ‘à reculons’. We begin with a group of three works which are settings of Blaise Cendrars, Jean Cocteau and Guillaume Apollinaire. The first two works are like miniature fanfares – the influences here are surely Satie and Stravinksy; the third, Le Bestiaire, is the cycle which most people know about (even if they have never heard it) and which, although written before the christening of Les Six, defines Durey’s relationship with Poulenc and Poulenc’s shorter cycle. It is a very special achievement in its own right. We then hear the two Heine settings which show Durey’s interest in German romanticism, something which always made him feel closer to Honegger than to Milhaud or Auric for example. Three slender works to words of Theocritus, Petronius and Parny mirror the refined understatement of Debussy and Ravel and the musical economies of Satie. The disc ends with Durey’s masterpiece – the extraordinary cycle Images à Crusoé where we hear the power and individuality of his voice in an extended setting of an important literary text.
Durey and his poets
Blaise Cendrars [Hommage à Erik Satie] was the pseudonym of the Swiss-born poet and novelist Frédéric Sauser Hall (1887-1961). Among the most exotically travelled of all French literati, his wayward unpredictability, his powers of observation, and his ability to weave an ongoing legend about his own life and experiences, made him a powerful figure in many overlapping creative circles in Paris. This one-armed man (his right arm was amputated as a result of military action in 1915) was, according to his friend Henry Miller, ‘a continent of modern letters’. By his old age he had become an inimitable institution, a ragbag of memories where truth and fantasy were sublimely indistinguishable. He was the friend of numerous painters (including Picasso and Picabia, Chagall and Sonia Delaunay) and was either in the centre, or on the fringes, of most of the seemingly outlandish artistic movements of the time such as surrealism and Dada. Satie and Cendrars found in each other kindred spirits: the poet’s anecdotes about this composer are among the most vivid evocations of Satie’s similarly unpredictable nature. In 1917, when many theatres and concert halls were closed because of the war, it was Blaise Cendrars who, together with the painter Moïse Kisling (a friend of Durey’s brother René), had the idea of putting on a concert at 6 Rue Huyghens, the studio of the painter Emile Lejeune. For this occasion the walls of the studio were decorated with canvases by Picasso, Matisse, Léger, Modigliani and others. Music by Satie, Honegger, Auric and Durey was played. It was this concert which gave Satie the idea of assembling a group of composers around himself to be known as ‘Nouveaux Jeunes’. Although it is always put forward that Cocteau somehow invented Les Six (a grouping which grew, after all, from the original ‘Nouveaux Jeunes’), it was Blaise Cendrars who founded the ‘Editions à la Sirène’ which published Cocteau’s Le Coq et l’Arlequin (as well as Poulenc’s Le Bestiaire and Durey’s Chansons basques) and who suggested the idea of combining concerts with exhibitions of painting.
Cendrars’ work has not received its due from musicians on the whole, but he has also been set by Honegger – the beautiful Pâques à New York for mezzo soprano and string quartet. It was Cendrars who provided Milhaud with the scenario for his ballet La Création du Monde.
The original title of Cendrar’s poem dating from November 1916 is Le Musickissme. (François Le Roux has pointed out that the English words ‘kiss me’ are deliberately embedded in the title.) Durey began his setting with the fourth line of the poem.
So much has been written elsewhere about the importance of Jean Cocteau (1889-1963) that the briefest of sketches must here suffice. Prodigiously talented and energetic, his abilities as both writer and artist ranged from poetry to novels, plays to revues; his unique line-drawings now seem one of the most exquisite by-products of the creative ferment in Paris in the years between the wars – part-serious, part-comical, gently louche, sometimes joyfully lewd, but always life-enhancing. Cocteau’s genius as a cinéaste is yet another aspect of his contribution to twentieth-century art. An important aspect of Cocteau’s success was his role as an animateur: he was an indefatigable networker with a gift for promoting himself and those loyal to him. One can scarcely think of the Paris of Diaghilev, Picasso and Stravinsky without imagining Cocteau as the self-appointed French plenipotentiary to these mighty foreign visitors – the mediating link between them and their French colleagues. It was the mondaine side of his character which obviously irritated Durey. Nevertheless, French music owes Cocteau much, if not quite as much as he himself might have looked forward to in 1920. Apart from the youthful Toréador, Poulenc chose to set only one set of poems by him (Cocardes) although he did return to Cocteau in the later part of his life for La voix humaine and La Dame de Monte-Carlo. Apart from songs by Les Six there are Cocteau settings by, among others, Lennox Berkeley, Louis Beydts, Paul Bowles, Maurice Delage, Erik Satie, Henri Sauguet and Jean Wiéner.The first two poems of Durey’s Chansons basques do not appear in a printed Cocteau collection. They were given to the composer in manuscript during the holiday the poet spent in the south of France with the Durey brothers in the summer of 1919. Cocteau had originally planned a third new text for Durey but the composer preferred something more sombre. The third poem, Attelage, appears in Poésie (1916-1923).
Guillaume Apollinaire (the pseudonym of Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, 1880-1918) is quite simply one of the greatest figures in French literature. English-speaking musicians and song enthusiasts are lucky to have in the many Apollinaire settings of Poulenc a ready-made and accessible entrée into the poet’s fascinating and endlessly fecund mind. If these songs – as well as those by Durey on this disc – only scratch the surface of his poet’s achievements, they make a good introduction to his work and encourage further exploration. It might be said that the Catalan Picasso and the Russian Stravinsky dragged French painting and music kicking and screaming into the twentieth century. Apollinaire, an art critic and joyful pornographer as well as a poet, was the first person to use the term ‘surrealism’; he persuaded French literature into the twentieth century with infinite grace and aplomb, his iron will disguised by charm and verbal magic which gracefully broke all the rules and remained a touchstone for the creative use of language. His advent spelled the end of the ‘Belle époque’ in literature, but he replaced symbolism with something more human and real, even if sometimes sur-real and puzzlingly allusive. It is little wonder that the young composers of the post-war years were at his feet. Sadly, his early death meant they could not get to know him, although Poulenc treasured memories of hearing the poet read his poems aloud at Adrienne Monnier’s bookshop in the Rue de l’Odéon.
The background to the story of how Apollinaire came to publish his Bestiaire perfectly illustrates the astonishing artistic milieu in which he lived and worked.
As one of Picasso’s best friends he was a frequent guest at the ‘Bateau Lavoir’ – the tenement studio on the Rue Ravignan where the great painter lived and entertained such colleagues as Derain, Braque and Gris. Apollinaire had seen some woodcuts depicting animals in Picasso’s studio. His voracious reading (his interests included magic, theosophy and medieval history) encompassed the bestiaries of the middle ages with their elaborately illuminated manuscripts. Why not, he thought, make a bestiary for modern times? As it turned out, Picasso was too busy to take part in the project so Apollinaire selected the painter Raoul Dufy who had been introduced to him by Derain.
Dufy was enthusiastic about the task. Woodcuts had suddenly become fashionable again. Gauguin had illustrated his South Seas journal Noa Noa with woodcuts, and Apollinaire’s first book L’enchanteur pourrissant had been given a haunting presence by the woodcuts of Derain. As it turned out, these animal illustrations, painstakingly printed by hand-press, were so perfect for Apollinaire’s succession of quatrains that it is difficult to tell which came first, poem or picture. The book, a veritable work of art, was expensive to produce, and it was not the hoped-for financial success. Of the 120 copies printed only fifty were sold at a hundred francs apiece before the book was remaindered. Those who bought it for forty francs acquired a stunning bargain – a bibliophilic treasure that was (as Apollinaire himself put it on the prospectus) ‘one of the most varied, seductive, and accomplished poetical works of the new generation’.
Poulenc, on the advice of Auric, suppressed six of his Bestiaire settings, but he had only composed twelve in all (there are four others – La Souris, Le Serpent, La Colombe and La Puce – which emerged at a later date). Durey determined to set all the animal poems, leaving out only those devoted to Orpheus. Apollinaire’s work is divided into four sections: eleven poems are devoted to creatures who tread the earth; then follow four insect poems; after this, five quatrains for the inhabitants of the sea; and then six concluding poems about mystical or magical creatures who symbolise both heaven and earth. Each of these four sections is introduced by a different ‘Orphée’ poem (the work is subtitled ‘Cortège d’Orphée’) which Durey did not set. On this disc these four extra items are read by François Le Roux so that we are able to present a complete version of Apollinaire’s great sequence.
Heinrich Heine (1797-1856) is the poet of Schumann’s Dichterliebe and Schubert’s Schwanengesang (among many others) but he was also an adopted Parisian and important figure linking German and French romanticism. The two poems selected by Durey are both from the ‘Die Heimkehr’ section of Heine’s Buch der Lieder (1827). This signifies a sympathy for ‘heavier’ German culture typical of Durey’s serious temperament – only Honegger among Les Six was similarly drawn to this tradition. It is true that Heine was also a celebrated radical and a hero of the Left – a fact no doubt known to Durey but not discernible from these texts. The first poem is No 53 of Die Heimkehr (‘Verriet mein blasses Angesicht’) and the second is the celebrated ‘Du bist wie eine Blume’ (No 47) which Schumann set in 1840 as part of his Myrthen and which was also set by Liszt, Ives and Lord Berners (at about the same time as Durey). Of other musical settings of the first song – Durey’s title is Mon pâle visage – I can only trace one, by Schumann’s contemporary Stephen Heller. Durey’s decision to set Heine in French translation (his own?) makes him the successor of such an unfashionable composer as Guy Ropartz who had set translations of poems from the Lyrisches Intermezzo in 1899.
Petronius (died AD 66) was the ancient Roman author of the episodic and inventive Satyricon, said to be the first European novel. His real name was probably Titus Petronius Niger and he held the title of ‘Arbiter’ – the ultimate aesthetic adviser and judge of taste, a post to which he was appointed by the Emperor Nero. This shows some artistic discrimination on Nero’s part, for Petronius was without doubt a talented man; but the enmity of Seneca marked him out as an upper-class wastrel. His reputation for decadence and facile indolence has come down to us through the Annals of Tacitus. When he was falsely implicated in a plot to assassinate the emperor, Petronius committed suicide by slitting his veins, entertaining his friends the while with witty conversation. Durey used the Œuvres complètes de Pétrone in the translation of Héguin de Guerle. At the end of this book, in a section titled ‘Fragments attribués à Pétrone’, the cycle’s three poems are to be found in prose translations, freely re-worked by the composer. The second song La Métempsychose is marked as an ‘imitation of Plato’, and Guerle notes that Clément Marot (1496-1544) in his ‘D’Anne qui me jecta de la neige’ (set by Ravel) was influenced by the Petronius poem which gives us La Boule de Neige. (Was this a covert hommage à Ravel on Durey’s part?). More recent research (Jean-Claude Margolin, 1980) has revealed that this poem was not by Petronius at all, but was rather one of several sixteenth-century Latin lyrics on this theme written in the wake of the first appearance of Marot’s poem in 1534. This genre of lyric was part of a Petrarchan revival in Europe which influenced Spenser and Shakespeare among others.
Theocritus (c310BC-c250BC) was an ancient Greek poet who lived and worked for most of his life in Sicily. He was said to be the creator of the idea of pastoral poetry and wrote in various forms. The bucolics and mimes are thought mostly to be authentic, but the twenty-four epigrams are less certainly ascribable to Theocritus. Durey used the translations of François Barbier. The mood of the poetry, whether authentic in this case or not, derives from real life – a Mediterranean background of sun and sea and flowers. There is a certain earthiness which appealed to Durey combined with the other-worldliness of the ancient world, an Attic simplicity which acknowledges the limpidity of Debussy’s Chansons de Bilitis and Satie’s Socrate.
Evariste Parny (1751-1814) was born to a rich Creole family on the island of Réunion, a French overseas colony in the western Indian Ocean. He was thus France’s first poet of colour and the precursor of Leconte de Lisle (also born in Réunion) in this and also stylistic respects. Parny’s masterpiece is Poésies érotiques (1778), a sequence of love poems in four sections which charts the course of his passion for Esther Trousaille whom he hymned under the name of Eléonore. For his miniature cycle of two songs Durey encapsulates the whole relationship by selecting a poem from Livre I (‘Vers gravé sur un oranger’) and one from Livre IV (‘Elégie III’) in which the poet wishes to efface the inscription carved on the tree in the first song. The ups and downs of love are perfectly reflected in these two slender pieces which are cleverly conceived as mirror-images in a type of musical and emotional contrary motion. Perhaps it was Durey’s interest in Parny which drew the attention of his friend Ravel to the Chansons madécasses? Those island evocations are, in turn, a sort of Ravellian Images à Crusoé.
Saint-John Perse, pseudonym of Alexis Saintléger Léger, also known as Alexis Léger (1887-1975) is one of the most important and yet mysterious figures in French literature. His different names betoken a man with double or triple lives. He was born on Saint-Léger-les-Feuilles, a small coral island off Guadeloupe, studied medicine in Paris, and the very un-French ‘Saint-John’ seems an indication of certain transatlantic affiliations. His poetry is highly valued in France but he has remained almost unknown to English-speaking readers despite translations by T S Eliot and others. He became a career diplomat who held senior postings in China, explored the South Seas, and eventually became an outspokenly anti-Fascist ‘secrétaire général des affaires étrangères’ in the French government toppled by Hitler. He was exiled by the Vichy régime (his unpublished work was destroyed during the German looting of Paris) and lived in America between 1940 and 1957, working as a consultant on French literature to the Library of Congress. His nine volumes of poetry (published between 1911 and 1971) are milestones in a career of voluntary anonymity. He wanted his work to speak for itself and, even if he chose to hide himself from the public’s gaze, his poetry had a glorious career. In the early days it was immediately hailed by Gide, Proust, Apollinaire and Breton, and the universal admiration of the French literary world continued in like fashion. The award of the Nobel Prize for Literature in 1960 seemed a natural culmination of a lifetime of achievement for a poet whom many had compared to Rimbaud.Thanks to Durey’s perspicacity, he discovered Saint-John Perse’s work right at the beginning of the poet’s career. Perhaps he had heard about him from their mutual friend Satie; in any case Saint-John Perse was in China at the time of the cycle’s composition. The first collection of poetry Eloges (which includes the Images à Crusoé) was published in 1911, but Durey found the text in an earlier version (where the author is named as ‘Saintléger Léger’) in a copy of La Nouvelle Revue Française of August 1909. (This accounts for the differences in the text between the songs and the published version of the poems.) This is symbolist poetry based not on the ivory tower of fantasy and disdain but on the sordid facts of daily existence and survival. For this Robinson Crusoe his island is only a memory; he is a dispossessed savage, urbanised against his will. In returning to the world of men, bringing his Man Friday with him, he is forced to encounter the squalors of town life. Crusoe has been brutalised physically by the hardships of his island, and is now mentally tortured by being away from it. The various scenes are permeated by memory and regret as if a grubby child had been abandoned in a hostile world. This puts us in mind of one of Berlioz’s phrases describing his adolescence: ‘Life was evidently outside me, far away, very far’. If the descriptions of plant and animal life in the South Seas seem too exotic to be true there is also an exactness in images which Saint-John Perse drew directly from his childhood in the Antilles (W H Hudson recalls his childhood spent in Argentina in a similarly accurate yet poetic way in Tippett’s Boyhood’s End). Saint-John Perse is always able to produce rich, almost untranslatable, pictures that are simultaneously exotic and banal, even vulgar: and yet the harsh aspects of day-to-day living (whether on the island or in the city) are described in a language that is powerfully nostalgic. Crusoe has lost his Eden, but he has also lost his ability to survive in the real world. But which of the two worlds is real? The distance between the ‘rescued’ Robinson Crusoe and his island is a metaphor for the gulf between childhood and the adult state, between the present and the past. The resulting poetry seems at time to have been produced in an intoxication of reverence for nature in all its brutal glory – one is carried away by the sweep of the descriptions which seem comparable at times to the earthy hymns to Welsh life by Dylan Thomas – earthy yet also high-flown, the product of a rare learning and mastery of language. Of Thomas’s humour there is less sign; Crusoe’s plight is dark and irremediable.
Durey, in some ways a musical Gauguin whose instincts were to withdraw from the glamour of urban life into his own island, must have felt a sympathy with these texts: the struggles to adjust to city life of Robinson and Friday (once a dignified savage, now grotesquely attired in a cast-off red coat) must have struck a chord with Durey as he himself attempted to fit in with the snobberies of le Tout-Paris. At least Friday and Crusoe are workers and survivors, they have a strength and integrity which shames the dandy or aesthete. This abrasiveness, a directness that is mirrored in these settings, is combined with a rare and poetic atmosphere which unobtrusively, and almost unexpectedly, pervades both text and music. Little wonder that Durey also allows himself to acknowledge Debussy and Ravel and the ‘calme’, ‘luxe’ and controlled ‘volupté’ which lies at the heart of the French creative spirit. Durey’s is not the glorious dream of Duparc’s L’invitation au voyage: his Images à Crusoé was written in the wake of a terrible war, and for a crueller and less forgiving century.
Graham Johnson © 2002
Des six compositeurs que le critique Henri Collet réunit dans un article publié en janvier 1920 sous le nom de « Groupe des Six », Francis Poulenc est sans aucun doute le plus connu – sa musique apparaît régulièrement tant dans les salles de concert que sur disques. Considéré comme un compositeur majeur, Darius Milhaud possède un vaste catalogue embrassant de nombreuses formes musicales. La musique orchestrale et chorale d’Arthur Honegger est mise à l’affiche de concerts avec une certaine régularité tandis que la musique de film de Georges Auric maintient la réputation du compositeur, quoique peut-être pas de la manière qu’il eût souhaitée. Largement inconnue de son vivant, voire même inédite, Germaine Tailleferre a bénéficié du regain d’intérêt envers les compositrices, une des caractéristiques de la recherche musicologique de ces dernières années.
Après avoir cité cinq membres du groupe, il nous reste le sixième, Louis Durey, qui a toujours donné l’impression d’être l’orphelin des Six. Homme fier et indépendant, il aurait certainement détesté qu’on s’en apitoie. Membre éphémère d’une « jeunesse musicale dorée » avec qui il avait pourtant peu en commun en termes de tempérament, il poursuivit stoïquement sa carrière une fois passés les jours grisants de ce cénacle juvénile et, peu désireux de faire partie d’un establishment musical, il demeura fidèle à ses convictions d’homme de gauche. Durey refusa de participer aux Mariés de la tour Eiffel, une œuvre créée en 1921 conçue en collaboration par « les Six » et Jean Cocteau. Et sa décision laissa Cocteau passablement mécontent. Si 1924 constitue la date officielle de la dispersion du groupe, il est clair que dès cette époque-là, 1921, les Six n’existaient plus comme une entité – si tant est que cette entité ait jamais existé.
Bien que Durey ait vu le jour à Paris, sa musique fut largement exécutée hors de la capitale. Le compositeur en vint même à détester l’univers de la société « mondaine » où la plupart de ses collègues contemporains évoluaient. Il avait pour ambition d’écrire de la musique dans un langage non-élitiste. Durant sa carrière, Durey fut membre de la Fédération musicale populaire dont il devint par la suite le Secrétaire. The Workers’ Music Association, l’organisme qui, en Grande-Bretagne, joua un rôle équivalent, reçut un soutien comparable du compositeur anglais encore largement sous-estimé, Alan Bush, lequel y consacra une bonne partie de sa carrière. Comme lui, Durey souscrivit aux principes du Manifeste de Prague de 1948 qui appelait les musiciens progressistes à démocratiser leurs compositions en abandonnant l’individualisme et en écrivant une musique dérivée du chant populaire.
Ses sympathies communistes, alors largement impopulaires, ne lui furent pas d’un grand secours pour faire avancer sa carrière. Après sa rupture avec Cocteau, Durey ignora l’univers sophistiqué et chic des salons de l’entre-deux-guerres. Lors de l’occupation Nazie, il dut faire face aux dangers encourus par tout membre de la Résistance et écrivit des chansons antifascistes. Puis avec le climat de la Guerre froide ajouté à ses convictions politiques, les commandes et exécutions se firent désirer. Durey semble avoir été indifférent à tous ces revers. La renommée, le chic et l’influence d’auteurs français de gauche comme Sartre ne semblent pas avoir touché des musiciens comme Durey. S’il devint critique musical de l’Humanité en 1950, c’est la musique aux mélodies inoubliables de Joseph Kosma qui brossa un portrait plus durable des mouvements littéraires parisiens des années 1950 et 1960.
Né le 27 mai 1888, Louis Durey grandit dans un environnement enclin à toute chose artistique, dans un milieu pragmatique où une sensibilité esthétique était associée à la fierté de l’artisan et à la discipline de la production industrielle. Son père était propriétaire d’une firme qui manufacturait des caractères d’imprimerie. Son frère, René, devint un peintre qui, au début des concerts donnés par les « Nouveaux Jeunes », encouragea aussi l’idée associant musique et peinture. Durey se développa tardivement. Ce n’est qu’à dix-neuf ans, après avoir assisté à une représentation de Pelléas et Mélisande de Debussy (il connaissait déjà quelques opéras de Wagner) qu’il se décida à embrasser une carrière musicale. Malgré son attirance pour des personnalités comme Schoenberg, Satie, Ravel et Stravinsky, il nourrit une inspiration fidèle envers Debussy. Des années après, il avouait que c’étaient « l’élégance suprême » de Debussy, sa « tendre et pénétrante poésie » qui avaient été son guide musical le plus sûr. Comme compositeur et orchestrateur, Durey était largement autodidacte, mais, entre 1910 et 1914, il trouva en Léon Saint-Requier, chef de chœur de la Schola Cantorum, un mentor décisif dans l’étude de l’harmonie et du contrepoint. Il n’est donc guère surprenant que la musique chorale ait d’emblée joué un rôle primordial dans la création de Durey. Son Opus 1 (1914) consistait en deux chœurs a cappella sur des textes de Henri de Régnier et Charles d’Orléans (deux poètes chers au cœur de Debussy – et l’on doit se rappeler que le grand compositeur était encore vivant à cette époque, présence distante et invisible évoluant à l’ombre de l’œuvre de Durey). Ce fut sans nul doute par cette association avec la Schola Cantorum que le jeune compositeur pénétra dans le cercle d’Eric Satie dont Durey qualifia par la suite les fameuses excentricités de « caprices de la nature ». Puis, en peu de temps, naquit une kyrielle de cycles concis de mélodies sur des poèmes de Paul Verlaine (Opus 2), Francis Jammes (Opus 3) et Rabindranath Tagore dans une traduction d’André Gide (L’offrande lyrique Opus 4), cette dernière page révélant l’influence passagère de l’atonalité d’Arnold Schoenberg.
Durey fut mobilisé en août 1915, mais il continua à écrire une musique vocale détachée des circonstances d’alors qui se posât en défi à l’humeur sombre et misérable de l’époque. Le Voyage d’Urien, un cycle sur des poèmes de Gide, date de ce temps-là, tout comme la réalisation chorale sur Saint-John Perse (Eloges – un précurseur important du cycle Images à Crusoé sur des poèmes de Saint-John Perse). Ce fut pourtant un duo pour piano qui causa la première sensation sur la scène musicale. Dédiée à Satie, cette pièce, intitulée Carillons, avait été inspirée par une visite au nord de l’Italie. Elle reçut sa première audition sous les doigts de Georges Auric et de Juliette Meerovitch en juin 1917. Si au premier abord, cette œuvre donna l’impression d’avoir été conçue dans l’ombre du Sacre du Printemps de Stravinsky, Durey convint par la suite que cette évocation de cloches carillonnant dans différentes tonalités fut bien plus influencée par les Cloches à travers les feuilles de Debussy. Carillons et sa suite Neige attirèrent l’attention de Maurice Ravel lors d’un concert donné dès 1918. (Figuraient également au programme Tailleferre, Honegger, Auric et Poulenc – dont la Rapsodie nègre fut créée au cours de la même occasion). Si Ravel semble avoir été moins impressionné par Poulenc, il se présenta à Durey de sa propre initiative et le recommanda immédiatement à l’éditeur Jacques Durand. Dans une lettre pleine d’amitié et de délicatesse, Ravel offrait aussi au jeune compositeur de l’aider à propos d’éventuels points d’orchestration si tant est que Durey en ait éprouvé le besoin. Jamais Durey n’oublia la gentillesse de Ravel. Et ce fut même la cause indirecte de sa rupture avec Cocteau et les Six. A cette époque-là, Durey reçut aussi l’approbation de l’un des compositeurs français les plus fastidieux, Albert Roussel, qui écrivit une critique favorable dans The Chesterian en octobre 1919. Dans cet article, il faisait notamment l’éloge du Bestiaire, des Trois Poèmes de Pétrone et des Images à Crusoé.
Dans un premier temps, Durey avait fait partie du cercle de jeunes gens réunis autour d’Erik Satie. En compagnie d’Auric et d’Honegger, il avait même été qualifié de « Nouveaux jeunes ». L’amitié que Durey noua avec Ravel fut probablement une des raisons de la dissension qui s’ouvrit en novembre 1918 entre Satie et les trois compositeurs. La place se trouva libre pour l’arrivée d’un nouveau mentor et propagandiste – Jean Cocteau. Toutes les œuvres vocales que l’on pourra découvrir sur ce disque font partie de cette période extrêmement fertile de la vie de Durey, à savoir des années 1918 et 1919, avant ce qu’on pourrait appeler le « baptême » des Six au début de 1920. De onze ans l’aîné de Poulenc, Durey était le membre le plus âgé des Six – plus vieux que Cocteau même. On ne doit donc pas s’étonner si lorsque le benjamin du groupe s’attacha à réaliser son premier chef d’œuvre sur des textes tirés du Bestiaire d’Apollinaire, Durey était déjà un compositeur de mélodies chevronné avec ses pages vocales les plus importantes figurant déjà, pour l’essentiel, à son catalogue, avec pour collaborateurs, une palette impressionnante de poètes. Nous avons précédemment cité Saint-John Perse (une sommité littéraire généralement ignorée des compositeurs), mais Durey était également attiré par les traductions des classiques (Epigramme de Théocrite, Trois poèmes de Pétrone) tout comme par le poète du XVIIIième siècle Evariste Parny (Inscriptions sur un oranger) que Ravel mit ultérieurement en musique dans ses Chansons madécasses. L’enthousiasme qu’il nourrissait en commun avec Poulenc pour les textes du Bestiaire semble avait été une pure coïncidence. (De la même manière, cinq ans plus tôt, pratiquement en même temps, Debussy et Ravel s’étaient enflammés pour les poèmes de Mallarmé.) Quand Poulenc apprit que Durey avait aussi mis en musique les poèmes du Bestiaire – et chacun d’entre eux ! – il dédia ses six réalisations musicales sur ces mêmes sources littéraires à Durey. Effectivement, pour bien des chanteurs et accompagnateurs, les mots « à Louis Durey » placés en tête de la partition de Poulenc constituent la première et unique apparition du nom du compositeur.
Dans un premier temps, Durey fut l’âme, sinon le secrétaire des « Nouveaux Jeunes ». En juillet 1919, Jean Cocteau avait fait paraître un article (parmi bien d’autres) dans Paris-Midi sur ce groupe de compositeurs. Ce fut Durey qui en envoya une copie à son collègue Milhaud. Il lui demandait aussi de se fendre d’un morceau de piano pour un recueil à paraître chez Demets réunissant les six compositeurs qui allaient peu après être baptisés « Les Six ». Lui-même contribua d’une Romance sans paroles écrite en hommage à Mendelssohn. (Et le choix même de Mendelssohn, un compositeur si peu à la mode, aurait pu tirer la sonnette d’alarme sur le futur de Durey au sein du groupe). Durant l’été 1919, Durey et son autre frère Pierre partirent en vacances avec Cocteau au pays basque, dans le sud de la France. Le fruit musical de cette période prit corps à travers ses trois Chansons basques où la première rencontre du compositeur avec la poésie de l’ultra-parisien Cocteau est associée à une inclinaison pour l’idiome plus physique de la musique folklorique. Une autre pièce de Cocteau que Durey mit en musique – Printemps au fond de la mer – une réalisation plutôt laconique pour voix et dix instruments à vent en un paysage extraordinaire des grands fonds marins – reçut sa première audition le 31 janvier 1920 avec l’infatigable Jane Bathori, la soprano qui joua un rôle crucial dans la diffusion de la nouvelle musique d’alors.
Au premier abord, une bonne harmonie semblait régner entre Cocteau et Durey. Cocteau fit paraître une critique des deux Bestiaire de Poulenc et Durey exécutés côte à côte en des termes appropriés aux images animalières : « Là où Poulenc saute avec des pattes de jeune chien, Durey pose délicatement ses pieds de biche. L’un et l’autre naturels. » Tout jeune compositeur aurait pu considérer une telle publicité, ainsi que la protection d’un poète passé maître dans l’art des relations publiques, comme un atout précieux. Mais Durey avait décidé qu’il n’aimait pas beaucoup Cocteau. Il écrivit à Milhaud : « Jean est un être exquis, contre qui il est dur de se choquer, mais il a une légèreté d’esprit inconcevable et il joue au bébé avec une feinte ingénuité qui me gêne bien souvent. » Et il s’agit bien d’une condamnation de l’aspect narcissique et superficiel de la personnalité de Cocteau, une critique d’autant plus accablante qu’elle venait d’un membre de son propre cercle. Des compositeurs comme Poulenc et Milhaud eurent la capacité de voir au-delà et d’ignorer les irritations causées par le nombrilisme du poète, et leur amitié dura pendant plus de quarante ans. Mais Durey avait, de surcroît, des convictions qui divergeaient des dicta esthétiques de Cocteau. Dans un de ses articles publiés en mai 1920 dans Le Coq – de facto l’organe officiel des Six – Cocteau réitéra un des jugements les plus tranchés de Satie : « Ravel refuse la Légion d’honneur mais toute sa musique l’accepte. » Si Satie et Ravel avaient eu une relation passablement brouillée, Durey s’offusqua de voir Cocteau reprendre le même ton. Ce manque de courtoisie gratuit envers un grand compositeur français (en particulier de la plume de quelqu’un qui était, à sa manière, bien plus snob et mondain que Ravel), irrita Durey au point qu’il crut nécessaire de rompre définitivement les ponts avec les Six. En renonçant à écrire une Valse des dépêchés, il refusa de participer aux Mariés de la tour Eiffel – une œuvre avec laquelle Cocteau avait espéré présenter la collaboration définitive du groupe.
Milhaud fit de son mieux pour persuader Durey de revenir sur sa décision, suppliant son ami d’éviter ce qu’il appelait « une politique d’agression » et lui demandant de respecter ce que Poulenc appelait « l’unité variée » du groupe. « Tu aimes Ravel, Arthur [Honegger] aime [Florent] Schmitt. J’aime [Albéric] Magnard, Francis aime [Albert] Roussel, Tailleferre tout le monde et Auric personne. La liberté pour tous. Tant mieux si nos goûts divergent. Raison de plus pour n’en être que plus unis. » Une autre lettre où Cocteau essayait de persuader Durey de se laisser fléchir dénote clairement une note de pétulance et un sens de trahison personnelle. Rien n’y fit. Et avec le retrait de Durey du projet des Mariés de la tour Eiffel, c’était les Six, en tant que groupe, qui disparaissait. Dans Plain-Chant (publié en 1923), Cocteau incorpora un poème sur la manière dont il avait accueilli « ses » compositeurs :
« Auric, Milhaud, Poulenc, Tailleferre, Honegger
J’ai mis votre bouquet dans l’eau du même vase,
Et vous ai chèrement tortillés par la base,
Tous libres de choisir votre chemin en l’air. »
L’absence de Durey de cette liste, petit inventaire des possessions de Cocteau, est saisissante. A partir de ce moment-là, il ne fut plus question que d’arranger au mieux les photographies du groupe lors des anniversaires et occasions spéciales. Les clichés de 1931 et 1951 dévoilent la présence malaisée de Durey : il est situé soit en arrière plan, soit aussi éloigné que possible de Cocteau qui domine l’assemblée. Durey semble avoir apprécié la collaboration musicale de ses collègues (comme en témoigne la correspondance de 1959 avec Poulenc citée à la fin de cette notice), mais il pensait que les activités musicales du groupe avaient été prises en otage par un Cocteau soucieux, avant tout, de ses intérêts particuliers, car d’une manière qu’il trouvait facile et malhonnête, le poète parvenait ainsi à épater les bourgeois avec chic.
Hormis le soutien d’artistes issus de la même famille politique, Durey se trouva alors forcé de vivre dans l’isolement artistique qu’il s’était choisi, jusqu’à pratiquement la fin de ses jours. Comme il l’avait confié à Milhaud, il croyait en la naissance d’un nouveau romantisme, ce qui le plaçait aux antipodes de l’esthétique des Six. Cette quête d’une nouvelle voix romantique est perceptible dans le choix de deux poèmes de Heine – Deux lieder romantiques, le texte du second étant éternellement associé à Schumann. (A sa manière, en comparaison de sa production des années 20, Poulenc était également destiné à écrire une musique plus lyrique dans les années 30 : son postlude à Tel jour, telle nuit est un hommage caché aux Dichterliebe de Schumann.) Dans la décennie qui suivit la rupture avec Cocteau, Durey se retira au le sud de la France, dans sa propriété de Saint-Tropez. Là, il travailla dans un calme absolu à sa Cantate de la Prison et à son unique opéra L’Occasion dont la composition dura quelques années. Reposant sur une pièce de Mérimée, l’intrigue était sujette à controverse (deux jeunes filles dans un couvent sont tragiquement amoureuses du même prêtre), si bien qu’il fut impossible de mettre l’opéra en scène. Sa première audition – en version concert – eut lieu en 1974. Que Durey ait consacré une énergie aussi importante à un sujet que tout compositeur avisé aurait considéré sans avenir dans les théâtres lyriques de France, illustre soit une intégrité de fer, soit une ignorance aveugle des détails pratiques de la vie, ou bien encore peut-être les deux.
Après avoir épousé Anne Grangeon en 1929, le compositeur élut résidence à Paris en 1930. Durant cette période, il écrivit de la musique de chambre (son troisième Quatuor à cordes) et Dix Inventions pour piano. Il composa aussi la musique de scène de L’intruse, une pièce de Maeterlinck. Au milieu des années 30, il rejoignit le Parti communiste et devint actif au sein de la Fédération musicale populaire qui venait de se créer. Parmi les membres de l’organisation, il fit la connaissance d’autres compositeurs de gauche bien éloignés de l’univers social des Six – Charles Koechlin et son admirateur d’antan, Albert Roussel. Entre 1937 et 1944, Durey n’eut que peu de temps à consacrer à la composition puisqu’il s’engagea avec ardeur dans des travaux musicologiques. Il commença par reconstruire la musique oubliée de François-Joseph Gossec (1734-1829). Ce dernier avait tenté de composer une « musique pour le peuple » durant les années turbulentes de la Révolution Française et sa manière d’aborder la question semblait exemplaire pour un homme aux convictions de Durey. Ses études des madrigaux de Marenzio ainsi que de la musique vocale de Josquin des Prés et de Janequin témoignent de son constant engagement envers la musique chorale, une forme qu’il finit par considérer comme le véhicule le plus efficace des convictions politiques. Lui-même finit par écrire de nombreuses réalisations chorales dans les années 1950 et au début des années 1960 (dont des harmonisations de mélodies folkloriques de toute la France) dans un désir de fournir aux amateurs une musique accessible qui puisse être aisément apprise – une musique pour le peuple.
Durant l’occupation allemande, Durey fut un des musiciens qui s’engagea dans le Front National des Musiciens, une branche de la Résistance d’où maints noms célèbres brillent par leur absence. Parmi ses camarades figuraient Désormière, Manuel Rosenthal et Roland-Manuel. Après la guerre, Durey renoua avec la composition. Son engagement politique transparaît explicitement avec le choix des textes de sa musique vocale : García-Lorca, Langston Hughes et Ho-Chi-Minh, et bien d’autres poètes mineurs associés à la lutte des classes. Il devint de plus en plus persuadé que tout artiste avait pour obligation d’embrasser la ligne dure du communisme. Malheureusement, la musique de cette période ne possède ni l’aspect mélodique aisé de Kosma, ni le sens de mystère et de poésie qui avait imprégné ses œuvres antérieures. A la fin des années 50 et au début des années 60, on assista à une nouvelle éclosion d’œuvres de Durey où l’on perçoit quelques indices du retour de cette voix spéciale, doucement exotique, qui rendait sa musique aisément identifiable parmi celle des Six. A la lumière des développements politiques récents, on pourrait penser que ces années de quête envers des idéaux artistiques du communisme russe et chinois furent bel et bien perdues – et pourtant, il est quasiment certain que Durey en personne, fût-il encore en vie (il mourut le 5 juillet 1979), ne les aurait pas reniées, les considérant comme une fraction de la longue lutte à mener. Née dans les années 1960 de sa colère outragée envers une guerre injuste, son œuvre sur des thèmes vietnamiens donne l’impression d’être l’épanchement d’une voix musicale solitaire. Rétrospectivement, elle semble courageuse et nécessaire.
En 1920, Francis Poulenc écrivit à Durey pour lui faire part de son cinquième Impromptu, car, pensait-il, son ami l’apprécierait, l’œuvre étant « excessivement triste et grave ». On pourrait en déduire que, dès sa jeunesse, Durey était réputé pour son sérieux parmi ses collègues, même si dans une lettre écrite en 1933 à Poulenc, il dévoile son admiration pour la manière dont Ninon Vallin avait interprété les Airs chantés, des morceaux légers et pleins d’entrain de Poulenc. Au cours de 1959, Louis Durey et son vieil ami Francis échangèrent pour la dernière fois une touchante correspondance. A l’occasion de la sortie en microsillons des mélodies qu’il venait de graver avec Pierre Bernac pour Véga (peut-être le meilleur enregistrement du duo), Poulenc avait reçu des revues de presse parmi lesquelles il avait découvert un article de Durey. Celui-ci considérait que les mélodies de Poulenc faisaient maintenant partie des classiques et prenaient place à côté de celles de Fauré et Debussy. Conscient qu’une telle approbation n’était pas commune chez un homme d’une telle intégrité, Poulenc prit immédiatement la plume et dans une lettre concise mais pleine d’affection, il remercia Durey du compliment. Bernac, sur le point de prendre sa retraite, venait de chanter Le Bestiaire pour la dernière fois et l’esprit de Poulenc se transporta à cette époque de 1918 ou 1919, vers l’appartement de Durey, dans le quatorzième arrondissement, lorsque les deux cycles avaient été exécutés : « J’ai revu tout à coup la rue Boissonade. Heureux temps ! Je t’embrasse tendrement. »
La réponse de Durey mérite d’être citée dans son entier parce que nous pouvons y percevoir la voix du véritable ami et de l’artiste raffiné, qui dut lutter (ne serait-ce que pour essayer d’organiser des liens musicaux par-delà le rideau de fer) pour mener une carrière si différente de celle de Poulenc.
Saint-Tropez, ce 20 juin 1959
Bien cher Francis
Ta lettre vient de me parvenir ici, me causant l’extrême plaisir que tu peux imaginer. Tu me dis que « plus l’âge avance et plus tu aimes à te remémorer notre jeunesse ». C’est là le plus sûr moyen de refuser le vieillissement et, avec les onze années que j’ai d’avance sur toi, je puis t’assurer que la recette est des meilleures. J’ai le rare bonheur de ne pas ressentir trop encore les dégâts causés par la fuite du temps, et la jeunesse que je me figure posséder toujours s’alimente aux sources de notre amitiés, de notre prodigieuse amitié qui demeurera un exemple pour nos cadets. Il y a quarante ans que cela dure, cher Francis, et si le fameux article d’Henri Collet date des premiers jours de janvier 1920, il ne faisait que consacrer un état de fait qui s’était élaboré au cours des mois précédents et notamment avec les concerts du Vieux-Colombier animés par notre admirable Jane.
Ce serait, il me semble, une bonne chose que de nous réunir, un jour de l’automne qui vient, dans l’intimité pour y célébrer cette amitié de quarante ans et notre indéfectible solidarité. Si Arthur, hélas, nous a déjà quittés, sa mémoire est en nous et ne peut que cimenter davantage le lien qui nous unit. Ce serait en tout cas une grande joie pour moi si nous pouvions nous retrouver pour quelques bons moments.
J’avais bien pensé à t’envoyer le double des lignes que j’avais données à Europe au sujet de tes mélodies ; seule ma négligence habituelle, qui m’a fait remettre de jour en jour, m’a empêché de le faire. J’ai été très frappé, c’est vrai, en écoutant ces deux disques, de l’unité qui s’en dégage et du caractère définitif qu’y ont pris ces œuvres devenues véritablement classiques. J’ai eu, depuis, l’occasion de parler aussi de la Sonate pour flûte, si réussie, et du Trio.
Le voyage que je devais faire en Pologne a malheureusement avorté, le ministère des Affaires étrangères ayant refusé la subvention pour le voyage qu’il avait laissé espérer jusqu’au dernier moment. Le Concert des Six que j’avais préparé, a eu lieu malgré cela, avec la seconde Sonate de violon de Darius, les Chansons françaises de Germaine, les Apollinaire d’Arthur, le Trio d’anches de Georges, ta Sonate de flûte et mes Chœurs de métiers. Quant à la conférence que je devais faire, elle a été imprimée dans une revue littéraire polonaise. J’ai été très déçu, mais l’occasion se représentera peut-être une autre fois.
A propos du Bestiaire, tu me parles de la rue Boissonade. Je n’ai plus que peu de temps à y rester. Nous sommes en effet expropriés par l’Assistance publique qui est mitoyenne. La maison va être démolie et remplacée par la morgue des hôpitaux que l’on construit derrière chez nous. J’y ai trop de souvenirs pour n’en être pas navré. Aussi je me réjouis fort de notre maison de Saint-Tropez, le coin où nous sommes se trouve suffisamment à l’écart, à 2 km de la ville, pour que, même en plein été, nous soyons préservés du bruit et de l’agitation…
[…]
Je souhaite que nous ayons bientôt la possibilité de nous revoir. Mon affection pour toi demeure toujours aussi vive, aussi présente, aussi nécessaire.
Je t’embrasse.
Louis
A écouter la musique vocale de Durey, on perçoit distinctement que s’il fit partie des Six, ce fut plus le résultat du hasard que de tout autre chose – après la rupture avec Satie, en 1918, il suivit le courant et fit presque involontaire sien l’engouement d’alors, mais c’est surtout l’amitié et l’affection qu’il portait à ses jeunes amis musiciens qui l’attacha au groupe. Ce mouvement n’était pas en mesure de lui apporter un véritable enrichissement esthétique. En 1918, Durey avait plus de trente ans, (et s’intéressait nettement moins aux blagues joyeuses et choquantes que durant ses vingt ans), un facteur qui contribua probablement à ce décalage. La musique que nous avons enregistrée sur ce disque n’est donc pas présentée chronologiquement : arriver aux réalisations musicales sur des textes de Cocteau en fin de programme donnerait une image faussée du développement de Durey en tant que créateur de mélodies puisque dans ce domaine, il réduisit son activité dans les années 1920 au lieu de s’élancer dans un crescendo d’expressivité. Notre disque est donc plutôt conçu selon l’esprit de L’Ecrevisse d’Apollinaire – c’est-à-dire « à reculons ». Nous commençons par un groupe de trois recueils sur des poèmes de Blaise Cendrars, Jean Cocteau et Guillaume Apollinaire. Les deux premiers ressemblent à des miniatures de fanfares – l’influence de Satie et Stravinsky y est perceptible. Le troisième, Le Bestiaire, est le cycle dont la plupart des gens ont entendu parler (sans pour autant l’avoir entendu) et qui, s’il fut écrit avant le baptême des Six, définit la relation que Durey entretint avec Poulenc et le cycle plus concis de ce dernier. Il s’agit d’un accomplissement spécial en son nom propre. Nous pouvons ensuite découvrir ses mélodies sur deux poèmes de Heine ; elles témoignent de l’intérêt que Durey portait au romantisme allemand, un aspect qui l’a toujours rapproché d’Arthur Honegger plutôt que, disons, Milhaud ou Auric. Trois ouvrages plus modestes sur des textes de Théocrite, Pétrone et Parny s’inscrivent dans la veine de discrétion raffinée inaugurée par Debussy et Ravel et dans une économie de moyens similaire à celle de Satie. Le disque prend fin avec le chef d’œuvre de Durey – le cycle extraordinaire Images à Crusoé où nous pouvons découvrir la puissance et l’individualité de sa personnalité artistique dans une ample réalisation musicale conçue sur un des textes majeurs de la littérature française.
Durey et ses poètes
Blaise Cendrars [Hommage à Erik Satie] est le pseudonyme de Frédéric Sauser Hall (1887-1961), poète et écrivain d’origine suisse. Grand voyageur, il faisait partie, parmi les hommes de lettre français, de ceux qui avaient le plus parcouru les contrées exotiques. Son imprévisibilité capricieuse, son pouvoir d’observation et sa capacité à tisser une légende perpétuelle de sa propre vie et de ses expériences firent de lui une personnalité incontournable au sein de nombreux cercles parisiens. Cet homme manchot (son bras droit avait été amputé à la suite d’une action militaire en 1915), était, selon son ami Henry Miller, « un continent des lettres modernes ». Dans sa vieillesse, il était devenu une institution inimitable, un amoncellement de mémoires où le vrai et l’imaginaire s’entremêlaient sublimement. Il avait été l’ami de nombreux peintres (dont Picasso et Picabia, Chagall et Sonia Delaunay) et avait été mêlé à pratiquement tous les mouvements artistiques en apparence bizarres de l’époque, comme le surréalisme et le dadaïsme. Satie et Cendrars rencontrèrent en chacun l’âme sœur : les anecdotes du poète sur le compositeur font partie des évocations les plus vivides de la nature pareillement imprévisible de Satie. En 1917, alors que la guerre avait entraîné la fermeture de nombreux théâtres et salles de concert, ce fut Blaise Cendras qui, avec le peintre Moïse Kisling (un ami du frère de Durey, René), eut l’idée de présenter un concert au 6 rue Huyghens, dans le studio du peintre Emile Lejeune. Pour l’occasion, les murs du studio furent décorés de toiles de Picasso, Matisse, Léger, Modigliani etc. On y joua de la musique de Satie, Honegger, Auric et Durey. Ce fut ce concert qui donna à Satie l’idée de réunir un groupe de compositeurs autour de sa personne sous le nom des « Nouveaux Jeunes ». Si le rôle de Cocteau est toujours mis en exergue dans l’invention, pour ainsi dire, des Six (un groupe émanant des « Nouveaux Jeunes »), il ne faudrait oublier Blaise Cendras qui créa les « Editions à la Sirène » où fut publié Le Coq et l’Arlequin de Cocteau (tout comme Le Bestiaire de Poulenc et les Chansons basques de Durey) et qui suggéra d’associer des concerts à des expositions.
Quoique l’œuvre de Cendras n’ait pas reçu l’attention qu’elle méritait de la part des musiciens, elle a cependant aussi été mise en musique par Honegger avec une page magnifique, Pâques à New York pour mezzo soprano et quatuor à cordes. Ce fut Cendras qui donna à Milhaud un scénario pour son ballet, La Création du Monde.
Le titre original du poème de Cendras date de Novembre 1916 et fut publié dans Le Musickissme (François Le Roux a souligné que dans les mots anglais « kiss me » ont été délibérément incorporé au titre). Durey débuta la composition de mélodies avec la quatrième ligne du poème.
Il existe une profusion d’écrits sur l’importance de Jean Cocteau (1888-1963) [Chansons basques] si bien qu’un simple aperçu est suffisant dans le cas présent. Doué d’un talent prodigieux et d’une énergie sans faille, Cocteau s’illustrait comme écrivain et artiste dans un domaine allant de la poésie au roman, des pièces de théâtre aux comédies musicales. Encore aujourd’hui, son coup de crayon unique donne l’impression d’être un des produits dérivés les plus exquis de ce ferment créatif qui avait embrassé Paris dans l’entre-deux-guerres – mi-sérieux, mi-comique, aimablement ambigu, parfois joyeusement obscène mais toujours enrichissant. Le génie de Cocteau comme cinéaste est une autre facette de sa contribution à l’art du 20ième siècle. Un autre aspect majeur du succès de Cocteau se trouve être son rôle d’animateur. Il mobilisait sans relâche les gens qu’ils connaissaient, tissant autour de lui un vaste réseau de relations afin de se promouvoir et de pousser ceux qui lui étaient fidèles. On peut difficilement penser au Paris de Diaghilev, Picasso et Stravinsky sans imaginer Cocteau se posant comme le plénipotentiaire français de ces illustres visiteurs – intercédant entre ceux-ci et leurs collègues français. C’était le côté mondain de son tempérament qui irritait manifestement Durey. Quoi qu’il en soit, la musique française est largement redevable à Cocteau, toutefois dans une proportion moindre de ce qu’il aurait peut-être pu espérer en 1920. Hormis un Toréador de jeunesse, Poulenc choisit de ne mettre un musique qu’un recueil de poèmes de sa plume – Cocardes – même s’il retrouva Cocteau sur la fin de sa vie, avec La voix humaine et La Dame de Monte-Carlo. Mis à part les Six, on peut citer parmi les compositeurs qui ont écrit sur des textes de Cocteau Lennox Berkeley, Louis Beydt, Paul Bowles, Maurice Delage, Erik Satie, Henri Sauguet et Jean Wiéner.
Les deux premiers poèmes des Chansons basques de Durey ne font pas partie des collections publiées par Cocteau. Ils furent donnés au compositeur sous forme manuscrite durant les vacances que le poète passa dans le sud de la France en compagnie des frères Durey au cours de l’été 1919. Cocteau avait initialement prévu d’écrire un troisième texte pour Durey, mais le compositeur souhaitait quelque chose de plus sombre. Le troisième poème, Attelage, parut dans Poésie 1916-1923.
Guillaume Apollinaire (pseudonyme de Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, 1880-1918) [Le Bestiaire] est tout simplement l’une des plus grandes personnalités de la littérature française. A travers les compositions de Poulenc sur des poèmes d’Apollinaire, les musiciens anglophones et les amateurs de mélodies ont la chance de disposer d’une initiation aisée et intelligible à l’esprit fascinant et éternellement fécond du poète. Si ces mélodies – tout comme celles de Durey gravées sur ce disque – ne font qu’effleurer la surface de ce que le poète a laissé, elles constituent une excellent introduction à son œuvre et incitent à en explorer les moindres recoins. On pourrait dire que le catalan Picasso et le russe Stravinsky ont poussé la musique et l’art français à entrer malgré eux dans le 20ième siècle. Apollinaire, qui non content d’être poète sévissait aussi comme critique d’art et pornographe joyeux, fut la première personne à employer le terme de « surréalisme ». Fort de sa volonté de fer masquée par son charme et de sa magie verbale outrepassant suavement toutes les règles établies, il convainquit la littérature française d’oser s’aventurer dans le 20ième siècle avec une grâce et un aplomb infinis. A l’heure actuelle, son œuvre demeure encore une étape obligée pour quiconque souhaite explorer avec créativité la langue française. Son avènement marqua la fin de la « Belle époque » en littérature. Apollinaire remplaça le symbolisme par quelque chose de plus humain, de plus réel, même si de temps à autres s’y mêlait quelque allusion surréaliste ou curieuse. Il n’est pas étonnant que les jeunes compositeurs des années d’après-guerre aient été empreints de vénération à son égard. Malheureusement, sa disparition prématurée les empêchèrent de mieux le connaître. Poulenc, par exemple, se remémorait avec ferveur les instants où il entendit le poète lire à haute voix dans la librairie d’Adrienne Monnier, rue de l’Odéon.
Les circonstances qui amenèrent Apollinaire à publier son Bestiaire illustrent à merveille le milieu artistique étonnant dans lequel il évoluait et travaillait.
Puisqu’il était un des amis les plus intimes de Picasso, il était fréquemment invité au « Bateau Lavoir » - le studio de la rue Ravignant où le grand peintre vivait et accueillait ses collègues tels Derain, Braque et Gris. Dans le studio de Picasso, Apollinaire avait entraperçu quelques gravures sur bois dépeignant des animaux. Avide lecteur, (il nourrissait un vif intérêt pour la magie, la théosophie et l’histoire médiévale), il avait aussi lu les bestiaires du Moyen Age, des manuscrits aux enluminures recherchées. Pourquoi ne pas faire un bestiaire des temps modernes, songea-t-il ? Il se trouva que Picasso était trop occupé pour participer à un tel projet, si bien qu’Apollinaire fit appel au peintre Raoul Dufy que Derain lui avait présenté.
Dufy s’attela avec enthousiasme à la tâche. La gravure sur bois était tout d’un coup revenue à la mode. Gauguin avait illustré Noa Noa, son journal des mers du Sud, avec des gravures sur bois, et celles de Derain avaient octroyé au premier livre d’Apollinaire, L’enchanteur pourrissant, une présence lancinante. Il se trouvait que ces illustrations animales, laborieusement imprimées à la main, furent tellement parfaites pour la succession de quatrains d’Apollinaire qu’il est difficile de deviner ce qui, du poème ou de l’image, vit le jour en premier. Véritable œuvre d’art, ce livre coûta une petite fortune si bien que le succès financier n’atteignit pas le niveau espéré. Des 120 exemplaires imprimés, seuls cinquante furent vendus à cent francs chacun, avant que le livre ne fasse parti des invendus. Ceux qui en firent l’acquisition pour quarante francs réalisèrent une affaire remarquable – il s’agissait d’un trésor de bibliophile (comme Apollinaire le soulignait dans la brochure), une des œuvres poétiques les plus variées, séduisantes et accomplies de la nouvelle génération.
Des douze mélodies qu’il écrivit initialement sur Le Bestiaire, Poulenc en supprima six, sur les conseils d’Auric. (Quatre autres émergèrent ultérieurement – La Souris, Le Serpent, La Colombe et La Puce.) Durey, quant à lui, choisit de mettre en musique tous les poèmes animaux, n’écartant que ceux consacrés à Orphée. Le recueil d’Apollinaire s’articule en quatre sections : onze poèmes consacrés aux créatures qui vivent sur terre, quatre poèmes d’insectes, cinq quatrains sur les habitants des mers et six poèmes conclusifs sur les créatures mystiques ou magiques qui symbolisent à la fois le ciel et la terre. Chacune de ces quatre sections est introduite par un poème différent sur « Orphée » (l’œuvre est sous-titrée « Le Cortège d’Orphée ») que Durey ne mit pas en musique. Sur ce disque, ces quatre textes supplémentaires sont lus par François Le Roux afin de présenter une version complète de la grande séquence d’Apollinaire.
Heinrich Heine (1797-1856) [Deux Lieder Romantiques] est le poète des Dichterliebe de Schumann et du Schwanegesang de Schubert (entre autres). Mais il était aussi parisien d’adoption et joua un rôle crucial dans le rapprochement entre le romantisme allemand et français. Les deux poèmes que Durey retint, font partie de « Die Heimkehr », une section du Buch der Lieder (1827) de Heine. En accord avec le tempérament sérieux de Durey, ce choix permet de percevoir une affinité avec la culture allemande plus « chargée » – parmi les Six, Honegger était le seul à être également attiré par cette tradition. Il est vrai que Heine était un radical renommé, et pour la gauche, un vrai héros – un fait que Durey connaissait indubitablement sans pour autant que ce soit perceptible dans ces textes. Le premier poème est le huitième de Die Heimkehr (« Verriet mein blasses Angesicht ») et le second est le fameux « Du bist wie eine Blume » (le n°48) que Schumann mit en musique en 1840 dans Myrthen et qui fut aussi exploité par Liszt, Ives et Lord Berners (à peu près à la même époque que Durey). Parmi les éventuelles réalisations musicales de la première mélodie – parue sous le titre Mon pâle visage chez Durey – je n’en ai trouvé qu’une, de Stephen Heller, un contemporain de Schumann. La décision de Durey de mettre en musique la traduction française des textes de Heine (peut-être, d’ailleurs, est-ce la sienne), le pose en successeur d’un compositeur peu apprécié alors, Guy Ropartz, qui avait composé sur des traductions de poèmes extraits de Lyrisches Intermezzo en 1899.
Pétrone (mort en 66 apr. J.-C.) [Trois Poèmes de Pétrone] est l’auteur de Satyricon, un ouvrage inventif en épisodes considéré comme le premier roman d’Europe. Le véritable nom de cet écrivain de la Rome ancienne était plus probablement Titus Petronius Niger. Il portait le titre d’« Arbiter » – le conseiller en esthétique et le juge du bon goût ultime, un poste que lui avait attribué Néron. Avec cette nomination, l’empereur avait certainement fait montre d’une réelle capacité de jugement car Pétrone était indubitablement un homme de talent ; mais l’inimité de Sénèque lui valut d’être considéré comme un aristocrate gaspilleur. Sa réputation de décadent et d’indolent nous est parvenue à travers les Annales de Tacite. Quand il fut impliqué à tort dans un complot pour assassiner l’empereur, Pétrone se suicida en se coupant les veines, tout en amusant ses amis de sa conversation brillante et pleine de verve. Durey se servit des « Œuvres complètes de Pétrone » dans une traduction de Héguin de Guerle. A la fin de cet ouvrage, dans une section intitulée « Fragments attribués à Pétrone », figurent les trois poèmes du cycle, traduits dans une prose qui fut ensuite librement remaniée par le compositeur. La seconde mélodie La Métempsychose porte la mention « [comme une] imitation de Platon », et Guerle indique que Clément Marot (1496-1544) dans « D’Anne qui me jecta de la neige » (mis en musique par Ravel) fut influencé par le poème de Pétrone qui nous a donné La Boule de Neige. (Et l’on peut se demander si Durey ne rendait pas ainsi en secret hommage à Ravel.) De récents travaux (Jean-Claude Margolin, 1980) ont révélé que ce poème n’était pas du tout de Pétrone, mais qu’il faisait partie de plusieurs textes latins écrits sur ce thème au cours du 16ième siècle, à la suite de la première parution du poème de Marot en 1534. Ce genre doit être perçu dans le contexte du renouveau européen du pétrarquisme qui influença Spenser et Shakespeare parmi tant d’autres.
Théocrite (v. 310-250 av. J.-C.) [Epigrammes de Théocrite] était un poète de la Grèce antique qui vécut et travailla durant presque toute sa vie en Sicile. Il est considéré comme le créateur de l’idée de poésie pastorale. Ses écrits embrassent des formes variées. Les bucoliques et mimes sont jugés les plus authentiques, mais il est probable que les vingt-quatre épigrammes ne sont pas de sa plume. Durey se servit de traductions de François Barbier. L’atmosphère présente dans cette poésie, qu’elle soit authentique ou non, dérive de la vie réelle – une toile de fond méditerranéenne, du soleil, la mer et les fleurs. On y décèle un certain naturel qui a dû plaire à Durey, en sus d’autres traits de l’Antiquité, une simplicité attique qui adopte la limpidité des Chansons de Bilitis de Debussy et de Socrate de Satie.
Evariste Parny (1751-1814) [Inscriptions sur un oranger] vit le jour dans une riche famille créole de l’Ile de la Réunion, un département français d’Outre-mer situé dans l’Océan Indien. Premier poète de couleur que la France ait connu, il fut donc le précurseur de Leconte de Lisle (qui naquit également à la Réunion) à cet égard, les deux dévoilant aussi des affinités stylistiques communes. Séquences de poèmes d’amour en quatre sections, les Poésies érotiques (1778) constituent le chef d’œuvre de Parny. Elles dépeignent l’évolution de sa passion pour Esther Trousaille qu’il chanta sous le nom d’Eléonore. Pour son cycle miniature, Durey concentra toute cette relation passionnelle en deux poèmes : le premier du Livre I (« Vers gravé sur un oranger ») et le second du Livre IV (« Elégie III ») où le poète désire effacer l’inscription qu’il avait gravée dans l’arbre lors de la première mélodie. Les hauts et les bas amoureux se reflètent parfaitement dans ces deux pièces concises qui sont intelligemment conçues, à la manière d’images en miroir réalisées en mouvement contraire tant musical qu’émotionnel. Peut-être était-ce l’intérêt que Durey portait à Parny qui attira l’attention de son ami Ravel sur les Chansons madécasses ? Ces évocations des îles sont, en revanche, une sorte d’Images à Crusoé ravelliennes.
Saint-John Perse, pseudonyme d’Alexis Saintléger Léger, également connu sous le nom d’Alexis Léger (1887-1975) [Images à Crusoé] est l’une des personnalités les plus importantes et pourtant les plus mystérieuses de la littérature française. Ses noms différents attestent d’un homme à la vie double, sinon triple. Il vit le jour à Saint-Léger-les-Feuilles, une petite île corail près de la Guadeloupe, fit des études de médecine à Paris, et le « Saint-John » bien peu français pourrait indiquer certaines affiliations transatlantiques. Sa poésie jouit d’une renommée considérable en France alors qu’il est presque inconnu des lecteurs anglophones, bien qu’il ait traduit T.S. Eliot et autres auteurs anglo-saxons. Il embrassa la carrière de diplomate et occupa des postes importants en Chine ; il explora les mers du Sud et devint éventuellement un « secrétaire général des affaires étrangères » ouvertement antifasciste dans le gouvernement français renversé par Hitler. Il fut exilé par le régime de Vichy (ses manuscrits inédits furent détruits durant l’occupation allemande de Paris) et vécut aux Etats-Unis de 1940 à 1957, travaillant comme conseiller de littérature française à la Library of Congress. Ses neuf volumes de poésies (publiés entre 1911 et 1971) sont des événements majeurs d’une vie placée sous le sceau d’un anonymat volontaire. Saint-John Perse souhaitait que ses œuvres parlassent d’elles-mêmes. Même s’il choisit de se cacher du grand public, sa poésie fit une carrière glorieuse. D’emblée, Gide, Proust, Apollinaire et Breton avaient été émerveillés, et l’admiration universelle des hommes de lettres français se poursuivit de la même manière. Le Prix Nobel de Littérature en 1960 vint couronner avec naturel une vie de création d’un poète que bon nombre avait comparée à Rimbaud.
Grâce à sa perspicacité, Durey découvrit l’œuvre de Saint-John Perse au tout début de la carrière du poète. Peut-être en avait-il entendu parler à travers leur ami commun, Satie. Le poète était en Chine à l’époque où le compositeur entama l’écriture du cycle. Le premier recueil de poésies, Eloges (qui comprend les Images à Crusoé) fut publié en 1911, mais Durey trouva le texte dans une version antérieure (où le nom de l’auteur était « Saintléger Léger ») dans un exemplaire de La Nouvelle Revue Française d’août 1909. (Ceci explique les différences de texte entre les mélodies et la version publiée des poèmes). Il s’agit d’une poésie symboliste écrite non pas dans une tour d’ivoire pleine d’imagination et de dédain, mais élaborée sur les faits sordides de l’existence et de la survie quotidiennes. Pour ce Robinson Crusoé, son île n’est qu’un souvenir : il est sauvage et dépossédé, urbanisé contre sa volonté. En retrouvant l’univers des hommes, avec Vendredi à ses côtés, il est obligé d’affronter les conditions abjectes de la vie citadine. Crusoé avait été physiquement brutalisé par les difficultés rencontrées sur son île, il est maintenant torturé mentalement par le fait d’en être éloigné. Les diverses scènes sont imprégnées de ses souvenirs et regrets à l’image d’un enfant dépenaillé abandonné dans un monde hostile. Ceci nous rappelle Berlioz qui dans son adolescence éprouvait le sentiment que la vie était à l’évidence en dehors de sa personne, bien éloignée de lui. Si les descriptions de la vie animale et végétale dans les mers du sud semblent avoir été trop exotiques pour être vraies, on perçoit néanmoins une exactitude dans les images que Saint-John Perse tira directement de son enfance des Antilles. (W.H. Hudson évoqua avec une précision similaire et poétique son enfance passée en Argentine dans Boyhood’s End de Tippett.) Saint-John Perse a la capacité de toujours produire des images riches, presque intraduisibles qui sont à la fois exotiques et banales, voire vulgaires : et pourtant les aspects pénibles de la vie quotidienne (que ce soit aux îles ou en ville) sont décrits dans un langage d’une rare puissance nostalgique. Crusoé a perdu son Eden, mais aussi sa capacité à survivre dans le monde. Parmi ces deux univers, lequel est le réel ? La distance entre le Robinson Crusoé qui a été « sauvé » et son île, est une métaphore du gouffre qui sépare l’enfance de l’âge adulte, le passé du présent. La poésie qui en résulte semble parfois émerger de l’exaltation enivrée ressentie pour une nature prise dans toute sa gloire brutale – on est emporté par l’élan descriptif qui semble comparable aux hymnes terre-à-terre de Dylan Thomas chantant la vie au Pays de Galles – des hymnes terre-à-terre et pourtant élevés, fruits d’une rare érudition et maîtrise du langage. Il n’y a aucune trace, toutefois, de l’humour de Thomas. La condition de Crusoé est sinistre, irrémédiable.
Préférant instinctivement vivre dans son « île » propre plutôt que de se frayer au charme sophistiqué de la ville, Durey, qui par bien des aspects pourrait être un Gauguin musical, a dû éprouver une vive sympathie envers ces textes : les luttes que mènent Robinson et Vendredi pour s’ajuster à vie citadine (autrefois sauvage et digne, Vendredi est maintenant accoutré d’une défroque rouge grotesque) ont touché une corde sensible chez Durey qui lui-même tentait de s’adapter aux snobismes du Tout-Paris. Du moins Vendredi et Crusoé étaient-ils des travailleurs cherchant à survivre. Ils possédaient une force et une intégrité à faire honte aux dandys et esthètes. Le caractère abrasif et direct de ces réalisations musicales est associé à une rare atmosphère poétique qui imprègne discrètement, presque fortuitement, le texte et la musique. Il n’est guère étonnant que Durey se soit aussi permis de reconnaître le « calme », le « luxe » et la « volupté » contrôlée de Debussy et Ravel au cœur de l’esprit créateur français. Durey n’a rien du rêve glorieux de L’invitation au voyage de Duparc. Ses Images à Crusoé sont écrites au retour d’une guerre terrible, pour un siècle plus cruel et moins indulgent.
Graham Johnson © 2002
Français: Isabelle Battioni


