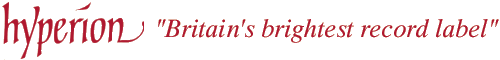
Welcome to Hyperion Records, an independent British classical label devoted to presenting high-quality recordings of music of all styles and from all periods from the twelfth century to the twenty-first.
Hyperion offers both CDs, and downloads in a number of formats. The site is also available in several languages.
Please use the dropdown buttons to set your preferred options, or use the checkbox to accept the defaults.

British organist Andrew-John Smith once again brings his compelling artistry to the service of Camille Saint-Saëns. Smith’s commanding sense of architecture, breathtaking musicality and astonishing control of dynamics and nuance is thrilling. As with Volume 1, this disc provides a rare opportunity to hear Saint-Saëns’s organ works played on the very instrument for which they were composed—the magnificent Cavaillé-Coll at La Madeleine, Paris.
The art of improvisation was essential for French organists and huge importance was placed on the development of this skill. Saint-Saëns was renowned for his extraordinary organ improvisations and it was said that ‘his genius was of an indescribable splendour’. In committing these extensive improvisations to paper he offers an insight into his instinctive musical logic and dazzling virtuosity. The Preludes and Fugues bear witness to the composer’s improvisatory flare and demonstrate the extent of his vastly imaginative compositional skills.

The fine art of improvisation, so French and in my opinion so necessary … (Camille Saint-Saëns, 1911)
Though he was, in his earlier years, a great promoter of German music, Saint-Saëns remained fiercely patriotic throughout his life and became a founding member of the Société Nationale in February 1871. Under its motto ars gallica this organization set about the promotion of French music and the establishment of a national style in those difficult years that followed the Franco-Prussian war. Despite considerable distinction Saint-Saëns was never far from controversy and for the last forty years or so of his life was perhaps known as much for his intransigence and outspoken views as for his musical accomplishments.
Saint-Saëns was one of music’s truly great prodigies. Following the death of his father two months after his birth he was brought up by a doting mother and great-aunt. At just two-and-a-half years of age he began playing the piano and was composing by the time he was five. In 1846 he gave his public debut at the Salle Pleyel. On this occasion he performed concertos by Mozart and Beethoven, a Bach Prelude and Fugue and works by Handel and Kalkbrenner. Not only did he perform without reference to scores, but for an encore he invited the audience to choose any one of the thirty-two Beethoven piano sonatas which he had also committed to memory! It is easy to see how such a precocious talent came to be compared with that of Mozart, whose music he adored, along with Bach, Haydn, Schubert and Mendelssohn. This list is revealingly conservative, and Reynaldo Hahn and Alfred Bruneau were not alone in describing him as ‘musical art’s last great classicist’. Saint-Saëns himself later recollected how ‘everything in my youth seemed calculated to keep me far removed from romanticism’.
He was one of the first significant composers to write solo music for the harmonium, and amongst the first French composers of the nineteenth century to write chamber music. Credited with almost single-handedly developing the solo concerto in France, he was also one of the first to incorporate genuine Arabic melodies into his scores, such as those in Samson et Dalila, or the Suite algérienne, Op 60. In 1908 he became the first notable composer to write a film score, with L’assassinet du Duc de Guise, Op 128, and was honoured as a member of the German Association of Musicians, a Grand Officer of the Légion d’honneur and a member of the Académie des Beaux-Arts. He was also awarded the German Order of Merit, an honorary doctorate from Cambridge University, the Cross of the Order of Victoria and had a museum devoted to him in Dieppe. A largely self-taught polymath, his interests and publications were as wide ranging as his career. They vary from astronomy, geology, archaeology, history, sculpture, painting and mathematics to anthropology, zoology, animal welfare and travel.
Accounts of Saint-Saëns’ improvisation are unanimous in their praise. Joseph Bonnet wrote that ‘no one who had the pleasure of hearing him will ever forget his extraordinary improvisations, so authentically classic in style and so dazzling in their virtuosity’, and several commentators, Joseph Ermend-Bonnal among them, remarked upon the impossibility of distinguishing these improvisations from written works. We are fortunate to have a number of early twentieth-century piano rolls which testify to this. It is from Jean Huré, however, that we learn the most of his improvisation at the organ:
Saint-Saëns’ genius as an improviser has often been praised, but these eulogies have always seemed insufficient to me. His genius was of an indescribable splendour … Following a marvellously ordered plan, he improvised counterpoint in two, three or four voices with such a purity and logic in the progression of parts that the most erudite musician with the most experienced ear believed he was hearing a thoughtfully, carefully written-down composition. So difficult were certain of these impromptus that it would have taken a year of assiduous work for our most skilled organists to play them.
For example, for the Sortie of the High Mass Saint-Saëns would improvise a strict fugue in three voices on the manuals. The clean, clear, incisive subject, the surprisingly ingenious countersubject, the exquisitely imaginative and inventive episodes would continue imperturbably in a vertiginous movement when all of a sudden in the stretto the last motet sung by the choir was heard in the pedal and continued as the entrances came closer and closer together until a dazzling conclusion. This he called a ‘little joke’. Lastly, I heard him improvise an Offertoire in which the right hand moved in legato fifths and sixths, the left hand arpeggiated wide chords from one keyboard to another while the pedal sang the melody in the tenor. And the rhythm did not falter for an instant.
The Sept Improvisations, Op 150, can best be understood not as free or whimsical pieces but as both a retrospective of the kind of performances he had given and as a template for good improvisatory practice. Why then did Saint-Saëns consider improvisation ‘so necessary’ and what did he regard as ‘so French’ about it?
From the earliest surviving keyboard music it is clear that improvisation was not just necessary but intrinsic to musical performance, and the two earliest extant sources, the Robertsbridge codex (c1360) and the Faenza codex (c1400), can be considered notated examples of a common improvisatory practice. Ornamentation, the stilus fantasticus, Italian partimento, English divisional practice and the realization of figured bass all speak of a long tradition of improvisation in performance, and though it is by no means confined to them, keyboard instruments are clearly particularly well suited to it. It need not surprise us therefore, that in a culture of improvisation as composition so many distinguished composers were revered for their improvisatory skills, Sweelinck, Buxtehude, Mozart, Beethoven, Liszt, Hummel and Chopin amongst them. Interestingly, in a number of cases contemporary comment suggests that improvisatory skill was sometimes even more impressive than the notated works. Saint-Saëns himself observed that it was often the case that lesser composers were more impressive spontaneously than on paper. He thought, for example that his predecessor at La Madeleine, Louis Lefébure-Wély, was a ‘magnificent’ improviser.
The early years of the nineteenth century witnessed a meteoric rise in the popularity of improvisation in response to the public taste for sensation and virtuosity. These, however, were the same characteristics which encouraged its decline as artistic originality was eclipsed by what John Rink has described as an ‘apotheosis of bad taste’. The rise of the performer as interpreter, as evidenced by the solo recital’s coming of age, and the attendant separation of composition from performance together with the adoption of improvisatory elements into compositional procedure, did nothing for the status of the art of pure improvisation. Whereas Czerny laid down formal procedures in his 1829 Systematische Anleitung zum Fantasieren aus dem Pianoforte, by the time the young Saint-Saëns entered the Paris conservatoire its use had become largely restricted to the organ loft.
Numerous improvisatory forms were developed exclusively for the church. These include the Prelude, Toccata and Intonazione, which were used as a constituent part of the Catholic liturgy, either as a means to establish tonality for the singers or to alternate with them. The Mass movements of Frescobaldi, for example, clearly demonstrate improvisatory origins. The strict auditions for organists at St Mark’s, Venice, in the early seventeenth century confirm the pervasive nature of this alternatim practice and the rigour with which it was to be treated, and as late as 1903 Pope Pius X was to reassert this in the moto proprio. Following the Reformation, Protestant countries developed their own alternatives to plainchant in the psalm or chorale and, whilst liturgical requirements were certainly different, the necessity for improvisation was not.
It is clear then that improvisation was demonstrably not a solely ‘French’ discipline. There are nonetheless various elements which lead to the notion of a national school. These arise first and foremost from the idiosyncrasies of French liturgy, use of plainchant, the reform of church music and the development of the symphonic instrument.
For at least two hundred years improvisation was a liturgical necessity in France and it became deeply ingrained in the musical culture. Permitted by a Papal bull of 1568, France developed its own ‘neo-gallican’ liturgy independently of Rome from the 1630s onwards. Begun by the Oratorians and later enforced as a policy of Louis XIV, this movement was in effect an attempt to assert Gallic heritage through the development of new liturgies, of which the Parisian was both the most important and the only one for which organ music survives. From a musical perspective the most significant difference between Paris and Rome was the requirement for organ music to include plainchant. Writing in 1844 Justin Cadaux, organist at Toulouse Cathedral, explained that whilst in France organ versets must always be upon chant, in the Roman rite they were entirely free. Though not the first document to lay down the rubric for this, the Caeremoniale parisienne (1662) was nonetheless the most important to do so. Abbé Leboeuf produced the Paris Antiphoner (1737) and the Paris gradual (1738) which contain a repertoire of both new and traditional chants. They remained the foundation of successive editions until the last was produced in 1846. The new style of chant, plainchant musical, blended traditional elements with modern melodic, harmonic and rhythmic convention. For example, the original version of the most famous Mass setting in this style by Henry Dumont (1699) had sharpened leading note ficta and mensural notation. Such settings could have no functional use beyond the rite for which they were written, and consequently there was a small amount of repertoire published for it.
Whilst there are examples of such repertoire by Fessy, Miné and, most significantly, Saint-Saëns’ early mentor Boëly, they are relatively few and tend to be straightforward in the extreme. With the notable exception of Boëly, published examples are often simple harmonizations of the chant with the cantus firmus presented in the lowest voice. Printed works were clearly aimed at the less accomplished player at a time when most organists improvised their own. As Varcollier noted, the organist not only needed technical command of his instrument but skill in harmony and counterpoint and the ability to improvise all that he played. The sheer amount of music that an organist was required to play under the Parisian rite necessitated a lot of improvisation. Nicolas Lebègue (c1631–1702) calculated that at St Merry, where Saint-Saëns later held his first position, he was required to play in the region of 8,000 versets a year. Both Mass and Office required organ versets performed in alternatim with plainchant sung by the choir as well as various pieces of incidental music. The Elevation, Communion, Offertory and Sortie all required solo organ music and though the character of each contribution was to change as the century progressed, the requirement for it did not.
In addition to the stipulation that certain versets should present the chant unaltered, various traditions were observed such as the provision of a fugue for the second verset of the Kyrie and hymns. At Vespers the organist contributed a verset after the first, third and fifth psalm and in some parishes after each psalm as well as in the hymn and the Magnificat. At the end of the service the organist played the Benedicamus and was often required to provide both introit and voluntary. If a Te Deum was required for an important occasion or feast day then the organist needed to provide sixteen versets for this alone. The popularity of the Te Deum, and in particular its constituent Judex crederis, was widespread in France at the end of the eighteenth and first half of the nineteenth centuries but given this culture of liturgical improvisation it should come as no surprise to learn that there are relatively few written examples.
In addition to the clear practical necessity for the French organist to improvise, for Saint-Saëns there was a second, more important imperative for it:
… it is improvisation alone which permits one to employ all the resources of a large instrument, and to adapt one’s self to the infinite variety of organs; only improvisation frequently develops faculties of invention which, without it, would have remained latent. I have spoken of Lefébure-Wély, whose published works for organ possess such scant interest, and who was a marvellous improviser; I might mention others whose improvisations were superior to their written compositions. Necessity, and the inspiring character of the instrument, sometimes accomplishes what premeditation is unable to achieve. It may excite surprise to learn that the Andante of my first Sonata for piano and cello and the conclusion to my Symphony in C minor were created on the manuals of the organ.
The importance placed upon improvisation and its relation to plainchant is reflected in the auditioning process for organists’ positions in the nineteenth century. Alexis Chauvet’s appointment at St Merry in 1864, for which Saint-Saëns was on the jury, required the performance of either an improvisation or a prepared piece, a fugue with pedals (chosen by the candidate), a plainchant accompaniment and an improvisation on a theme provided by Saint-Saëns. Similarly, when Widor was overseeing the selection of a new organist at St Denis in 1896 candidates were required to accompany plainchant, improvise a fugue, improvise a symphonic piece and perform a work of Bach from memory. For Vierne’s appointment at Notre Dame in 1900, under the supervision of Dubois, this was expanded to involve the obligatory plainchant accompaniment, improvised fugue, improvised free piece and now a memorized performance of a masterwork chosen by the jury from five offered by the candidate. Likewise, the organ competition at the Paris Conservatoire centred on improvisatory skills which in 1834 involved the improvisation of a four-part plainchant accompaniment and an improvised four-part fugue. In 1851 the chant was required to be placed in the soprano and bass successively. In fact the stipulation for the performance of a memorized fugue in 1852 was the first time anything other than improvisation was required. Categorized with harmony and counterpoint, the organ was found by an 1848 conservatoire commission to be ‘intended principally for improvisation’ and until Widor took the helm in 1890 most of the week’s teaching time was devoted to it. So prevalent was the practice that numerous contemporary observers, Danjou and Schmidt among them, were keen to point out that there was often no guarantee that an organist could actually play!
As the nineteenth century progressed the Roman rite was gradually reintroduced into French churches and shortly after Saint-Saëns’ first appointment at St Merry it was officially restored in Paris. The chapter of Notre Dame agreed its use in 1855 and made this mandatory in 1874, a year before Orléans completed the national process. This provoked the question, however, of precisely which chant to restore. As early as 1811 the chants used in the Roman rite since the fifteenth century were criticized as a corruption of those known from medieval manuscript sources. Reforms were begun in the 1830s by the Benedictines at Solesmes and were reflected in the publication of various treatises concerning plainchant theory and performance such as the Traité théorique et pratique (1855) of Louis Niedermeyer and Joseph d’Ortigue, and the Cours complet de plain chant (1855–6) of Adrien de La Fage. The performance of plainchant and the importance of earlier styles in restoring standards to church music were often prime concerns for the various institutions which arose for the promotion of church music. Chief among them were the Institution royale de musique religieuse, founded by Alexandre-Étienne Choron in 1825; the École Niedermeyer, founded by Louis Niedermeyer in 1853; the École d’orgue, d’improvisation et de plainchant, founded by Gigout in 1885; and the Schola Cantorum, École de chant liturgique et de musique religieuse, founded by Bordes, Guilmant and d’Indy in 1894.
It was at the Niedermeyer school that, as a piano teacher, Saint-Saëns held the only official teaching post of his life, from 1861 to 1865, and where he taught and later became lifelong friends with Gabriel Fauré, Eugène Gigout and Albert Périlhou. It is the Schola Cantorum, however, that can be regarded as the cornerstone of nineteenth-century efforts to reform French church music. It was begun with four main aims: to improve plainchant performance, to restore the style of Palestrina to the church, to create a modern repertoire inspired by these, and to improve the relevance of organ repertoire in relation to each of these three. Though applauding the intention, Saint-Saëns was critical of the Schola for promoting chant and the style of Palestrina at the exclusion of all else. Despite the fact that, at least for the Offertory, Saint-Saëns almost always used plainchant themes for his liturgical improvisations he was typically outspoken on the subject of chant. Confessing himself a sceptic of the reforms of Solesmes he questioned what he thought a futile attempt to rediscover the ‘primitive purity’ of chant. Nonetheless, he considered that their work would ‘doubtless be of great benefit’ and in fact he was far from opposing the use of either Palestrina or plainchant but argued, as he did so often, for balance. What he questioned was the limitation to earlier models at the exclusion of modern music and for this reason he also criticized the moto proprio: ‘Every epoch has the right to express religious sentiment in its own way.’ Nevertheless, he considered such limitations ‘a hundred times preferable to that drivel inflicted on us daily to the detriment of art and to the benefit of no one’.
Though plainchant was no longer a requirement in organ music it was still used to give order to the liturgy just as it had done for the Gallican rite. In reality the changes effected by the restoration were therefore those of style rather than ritual. The importance of chant to the distinctive French character of which Saint-Saëns wrote is reflected in Guilmant’s observation: ‘The German organists have composed pieces based on the melodies of chorales, forming a particularly rich organ literature; shouldn’t we do likewise with our Catholic melodies?’
In Italy and Germany these efforts were paralleled by the Caecilian movement as exemplified in the church music of Liszt and Bruckner. Whereas the Caecilians sought to revive the use of chant, however, the French tradition had been built around it. By the end of the century chant had so permeated musical consciousness that Widor was unable to perceive any French organ music as sacred unless consecrated by Gregorian chant. Nevertheless, from the 1870s onwards the organ began to enjoy new status as a concert instrument in France and repertoire appeared to support this. Where previously performances outside the church had been limited very largely to either inaugural concerts or ‘auditions’ at builders’ workshops, the increase in both the standard and integrity of organists began to win a new audience for the instrument. As both Saint-Saëns and Widor observed, the symphonic instruments of Aristide Cavaillé-Coll required new treatment and a new repertoire. The tradition of using plainchant themes for this, which began in the written works of Alkan, Lemmens, Gigout and Guilmant, continued via the music of Tournemire, Dupré, Duruflé, Langlais and Messiaen to the present day. In praise of the Niedermeyer system of chant accompaniment which preserved the modal character of melody, Saint-Saëns himself gave an apt summation: ‘His system has made its way throughout France, and has even surpassed its aim by showing us the possibilities of introducing the ancient modes into modern harmony, thus enriching it in an unexpected manner.’
Both the Prélude in F major and the two untitled miniatures recorded here survive only in manuscript sources at the Bibliothèque nationale. All three were printed for the first time in Otto Depenheuer’s 1991 edition where the miniatures acquired the working title of Deux Versets. Though they don’t belong together this is a good description of both the function and content of the pieces. As free works they might be used in all manner of liturgical situations and are surely typical, if youthful, examples of Saint-Saëns’ small-scale improvisations. Only seventeen bars long, motivic material is gently worked with exquisite craftsmanship. The slightly longer Prélude may also be used in this way though Depenheuer concludes that from a break in the manuscript it was originally intended to be part of a larger work.
Saint-Saëns wrote his Sept Improvisations, Op 150, between 9 December 1916 and 12 February 1917 whilst recovering in bed from bronchitis and gave their first performances in Marseille, Nice and Lyon a month or so later. With the exception of the Fantaisie pour Orgue-Aeolian of 1906 they are his first organ works since the Trois Préludes et Fugues, Op 109, written eighteen years earlier. It is to Périlhou, his friend and former pupil from the Neidermeyer school, that we should be eternally grateful for reawakening Saint-Saëns’ interest in the organ following his disillusionment and ultimate resignation from La Madeleine in 1878. Subsequent to the appointment of Périlhou as Organiste Titulaire of Saint-Sevérin at the beginning of 1891 Saint-Saëns was in the habit, accompanied by Fauré, of visiting him at the tribune each Sunday he was in Paris. The three friends would each contribute improvisations to the service before going out to lunch, Saint-Saëns often ‘dazzling his hearers with the magic of his magnificent improvisations’, according to Félix Raugel. Louis Vierne wrote of how Saint-Saëns loved to play the instrument at Saint-Sevérin and his contribution was clearly considered significant enough that in November 1897 he was given the title of honorary organist.
On completion of the Improvisations and before their first public performance Saint-Saëns went with Périlhou to the organ of the Temple de l’Étoile to play through them. The church’s organist, Alexandre Cellier, recalled in 1954 how Saint-Saëns had remarked on this occasion how enjoyable it was to play the organ; a comment he would scarcely have made in the years between 1878 and 1891. Whilst it would not be at all surprising to find the Op 150 set dedicated to Périlhou, it was in fact Gigout that received their dedication. Gigout, another of his Neidermeyer friends, was regarded by Saint-Saëns as one of the finest improvisers of his generation. Périlhou had retired in 1914 and as Gigout had been professor of organ at the Paris Conservatoire since 1911, where he included Saint-Saëns’ works among the repertoire, it seems at least possible that the set was intended to have some didactic value. Three of the set are titled and use plainchant themes. ‘Feria Pentecostes’ is based on the first hymn of Lauds for Pentecost, Beata nobis gaudia; ‘Pro martyribus’ employs three phrases from the Offertory of the Mass for a martyr, Gloria et honore coronasti eum; ‘Pro defunctis’ quotes from the Offertory of the Requiem, Domine Jesu Christe. It is interesting to note that in these movements Saint-Saëns colours his harmony with the mixolydian or aeolian modes whilst in the freely written pieces his language is more contemporary. Not since the Messe, Op 4, and the Six Duos, Op 8, had he used chant in his written compositions. The first piece is similarly unusual for its ambiguous whole-tone tonality.
The Trois Préludes et Fugues, Op 109, were completed in February 1898 at Las Palmas and are dedicated respectively to Fauré, Périlhou and Henri Dallier, who since 1879 had been organist of St Eustache and was to succeed Fauré at La Madeleine in 1905. On the receipt of a complimentary copy of the newly published work, Fauré wrote to Saint-Saëns: ‘Upon my return from London I found the superb Préludes et Fugues for organ which I will never be able to play properly, and I had the great joy of seeing my name at the head of one of them. I thank you a thousand times for this pleasant and flattering surprise.’
Saint-Saëns was renowned for his improvised fugues and Op 109 demonstrates well the ‘clean, clear, incisive subject, the surprisingly ingenious countersubject, the exquisitely imaginative and inventive episodes’ of which Huré wrote. Saint-Saëns himself related the anecdote of the bride who shocked him with the request not to play fugues at her wedding as they were too serious, and whilst Op 150 reveals an array of improvisatory possibilities, Op 109 attests also to the variety of his fugues. The first and third of Op 109, in D minor and C major respectively, are certainly cast in the grand style that he advocated for the instrument, though with varying characters. The G major, however, is full of the charm, grace and balance found in so much of his music. Vierne praised the works for their form and colour and asserted that they should be ‘… in the repertoire of any organist truly worthy of the name, as much for their superb style as for their virtuosic demands’.
Saint-Saëns’ contribution to national culture was as remarkable as his combination of improvisatory flare and intellectual rigour was rare. Less fashionable now than once it was, much of his music still awaits the full consideration that it deserves. For anyone that cares to look, however, it will surely be found both ‘so French’ and ‘so necessary’.
Andrew-John Smith © 2011
L’art de l’improvisation, si français et à mon avis tellement nécessaire … (Camille Saint-Saëns, 1911)
Même si, dans sa jeunesse, il a beaucoup contribué à faire connaître la musique allemande, Saint-Saëns a toujours été un patriote farouche et est devenu membre fondateur de la Société Nationale en février 1871. Sous sa devise ars gallica, cette organisation a entrepris d’assurer la promotion de la musique française et d’établir un style national en ces années difficiles qui ont suivi la guerre franco-prussienne. S’il s’est énormément distingué, Saint-Saëns n’est jamais resté en marge de la controverse et, au cours des quarante dernières années de sa vie, il était peut-être aussi connu pour son intransigeance et ses idées tranchées que pour ses réalisations musicales.
Saint-Saëns a été l’un des très grands prodiges de la musique. Orphelin de père deux mois après sa naissance, il a été élevé par une mère et une grand-tante qui l’adoraient. Il n’avait que deux ans et demi lorsqu’il a commencé à jouer du piano et cinq ans lorsqu’il s’est mis à composer. En 1846, il a fait ses débuts en public à la Salle Pleyel, jouant pour la circonstance des concertos de Mozart et Beethoven, un prélude et fugue de Bach et des œuvres de Haendel et Kalkbrenner. Il a joué non seulement sans se reporter aux partitions, mais, en bis, il a invité l’auditoire à choisir l’une des trente-deux sonates pour piano de Beethoven, n’importe laquelle, qu’il savait par cœur! On comprend aisément pourquoi on en est venu à comparer un talent aussi précoce à Mozart, dont il adorait la musique, tout comme celle de Bach, Haydn, Schubert et Mendelssohn. Cette liste est assez révélatrice d’un goût classique, et Reynaldo Hahn et Alfred Bruneau n’ont pas été les seuls à le qualifier de dernier grand adepte de «l’art classique». Par la suite, Saint-Saëns lui-même s’est souvenu combien tout dans sa jeunesse semblait calculé pour le tenir très éloigné du romantisme.
Il est l’un des premiers compositeurs importants à avoir écrit de la musique pour harmonium seul et il compte parmi les premiers compositeurs français du XIXe siècle à avoir composé de la musique de chambre. Reconnu comme celui qui a développé presque à lui tout seul le concerto pour instrument soliste en France, il a également été l’un des premiers à insérer des mélodies arabes authentiques dans ses partitions, comme dans Samson et Dalila ou la Suite algérienne, op. 60. En 1908, il est devenu le premier grand compositeur à écrire une partition de musique de film avec L’Assassinat du Duc de Guise, op. 128; en outre, il a eu l’honneur d’être membre de l’Association allemande des musiciens et a été fait grand officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur et membre de l’Académie des beaux-arts. Il a également reçu l’Ordre du mérite allemand, un doctorat honoris causa de l’Université de Cambridge, la Croix de l’Ordre de Victoria, et un musée lui a été consacré à Dieppe. Esprit universel largement autodidacte, ses centres d’intérêt et publications étaient aussi variés que sa carrière: de l’astronomie, la géologie, l’archéologie, l’histoire, la sculpture, la peinture et les mathématiques à l’anthropologie, la zoologie, la protection des animaux et les voyages.
Les comptes rendus des improvisations de Saint-Saëns sont unanimement élogieux. Selon Joseph Bonnet, quiconque a eu le plaisir de l’entendre n’oubliera jamais ses extraordinaires improvisations, si authentiquement classiques par le style et si éblouissantes par leur virtuosité, et plusieurs commentateurs, notamment Joseph Ermend-Bonnal, ont souligné l’impossibilité de distinguer ces improvisations d’œuvres écrites. Nous avons la chance de disposer de rouleaux perforés pour piano du début du XXe siècle qui en témoignent. C’est toutefois grâce à Jean Huré que nous en savons le plus sur ses improvisations à l’orgue; pour Huré, le génie de Saint-Saëns était souvent porté aux nues, mais ces éloges lui ont toujours paru insuffisants. Il lui trouvait un génie d’une splendeur inestimable:
Il improvise en contrepoint, à deux, trois, ou quatre voix, allegro, en suivant un plan merveilleusement ordonné, et avec une pureté, une logique, dans la marche des parties composantes, telles que le musicien le plus érudit et doué de l’oreille la plus exercée, croit entendre une composition mûrement pensée et écrite avec soin. Comme difficulté d’exécution, certains de ses impromptus représenteraient, pour le plus adroit de nos organistes, un an de travail assidu.
Saint-Saëns, par exemple, à la sortie de la grand’messe, improvise, aux claviers manuels, une fugue rigoureuse, à trois voix, réelles et suivies imperturbablement, dans un mouvement vertigineux. Le sujet est net, clair, incisif, le contresujet étonnant d’ingéniosité, les divertissements exquis de fantaisie et d’invention, et, tout à coup, dans le stretto, il fait entendre, au pédalier, le dernier motet qui fut chanté au chœur, et poursuit ses entrées, de plus en plus resserrées, comme il convient, jusqu’à une conclusion éblouissante. C’est ce qu’il appelle une «petite facétie».
Dernièrement, je l’ai entendu improviser un offertoire construit sur un trait de main droite, en sixtes et quintes liées, la main gauche arpégeant des accords dans toute l’étendue d’un autre clavier, pendant qu’au pédalier chantait un chant de ténor. Et pas un instant le rythme ne fut abandonné.
Les Sept Improvisations, op. 150, ne doivent pas tant être comprises comme des morceaux libres ou fantaisistes que comme une rétrospective du genre d’exécutions qu’il donnait et comme un modèle de bonne pratique de l’improvisation. Pourquoi Saint-Saëns jugeait-il l’improvisation si «nécessaire» et que lui trouvait-il de «si français»?
Il ressort de la musique pour clavier la plus ancienne dont nous disposons que l’improvisation n’était pas simplement nécessaire mais intrinsèque à l’exécution musicale, et les deux sources les plus anciennes qui nous sont parvenues, le codex de Robertsbridge (vers 1360) et celui de Faenza (vers 1400), peuvent être considérées comme des exemples notés d’une pratique d’improvisation commune. L’ornementation, le stilus fantasticus, le partimento italien, la divisional practice anglaise et la réalisation de la basse chiffrée témoignent d’une longue tradition d’improvisation dans l’exécution et, si elle ne se limite en aucun cas à eux, les instruments à clavier sont particulièrement adaptés à cette pratique. Il n’est donc pas surprenant que, dans une culture de l’improvisation comme la composition, tant de compositeurs éminents aient été révérés pour leurs talents d’improvisateurs, notamment Sweelinck, Buxtehude, Mozart, Beethoven, Liszt, Hummel et Chopin. Il est intéressant de noter que, dans plusieurs cas, la critique contemporaine constate que le talent d’improvisateur était parfois même plus impressionnant que les œuvres notées. Saint-Saëns a lui même observé que des compositeurs de moindre importance étaient plus impressionnants spontanément que sur le papier. Il pensait, par exemple, que son prédécesseur à la Madeleine, Louis Lefébure-Wély, était un «merveilleux improvisateur».
Les premières années du XIXe siècle ont vu une montée fulgurante de la popularité de l’improvisation en réponse au goût du public pour la sensation et la virtuosité. Ce sont néanmoins les mêmes caractéristiques qui ont contribué à son déclin car l’originalité artistique s’est trouvée éclipsée par ce que John Rink a appelé une «apothéose du mauvais goût». La montée en puissance de l’exécutant comme interprète, dont témoigne la multiplication des récitals en solo, et la dissociation concomitante de la composition et de l’exécution, avec l’adoption d’éléments d’improvisation dans la démarche créatrice, n’ont rien fait pour le statut de l’art de l’improvisation pure. Si Czerny a défini des procédés formels dans son Systematische Anleitung zum Fantasieren aus dem Pianoforte de 1829, à l’époque où le jeune Saint-Saëns entrait au Conservatoire de Paris, son utilisation est restée limitée à la tribune d’orgue dans une large mesure.
De nombreuses formes d’improvisation se sont développées exclusivement pour l’église. Elles comprennent le prélude, la toccata et l’intonazione, qui étaient utilisés comme partie constitutive de la liturgie catholique, soit comme moyen d’établir la tonalité pour les chanteurs soit pour alterner avec eux. Les mouvements de messe de Frescobaldi, par exemple, démontrent clairement des origines liées à l’improvisation. Les épreuves strictes de recrutement pour les organistes à l’église Saint-Marc de Venise au début du XVIIe siècle confirment la nature envahissante de cette pratique alternatim et la rigueur avec laquelle il fallait la traiter; et aussi tard qu’en 1903, le pape Pie X l’a réaffirmé dans le moto proprio. À la suite de la Réforme, les pays protestants ont développé leurs propres alternatives au plain-chant dans le psaume et le choral et, si les besoins liturgiques étaient certes différents, la nécessité de l’improvisation ne l’était pas.
Il est clair que l’improvisation n’a pas été à l’évidence une discipline exclusivement «française». Néanmoins, divers éléments mènent à la notion d’une école nationale. Ils proviennent avant tout des particularités de sa liturgie, de l’utilisation du plain-chant, de la réforme de la musique religieuse et du développement de l’instrument symphonique.
Pendant au moins deux siècles, l’improvisation a été une nécessité liturgique en France; au cours de cette période, elle s’est profondément ancrée dans la culture musicale. Autorisée par une bulle papale de 1568, la France a développé sa propre liturgie «néogallicane» indépendamment de Rome à partir des années 1630. Lancé par les oratoriens, puis renforcé par la politique de Louis XIV, ce mouvement a cherché dans le fond à affirmer l’héritage français par le développement de nouvelles liturgies dont celle de Paris était à la fois la plus importante et la seule pour laquelle de la musique d’orgue nous est parvenue. D’un point de vue musical, la plus grande différence entre Paris et Rome consistait dans la nécessité pour la musique d’orgue d’inclure le plain-chant. En 1844, Justin Cadaux, organiste de la cathédrale de Toulouse, expliquait que si en France les versets à l’orgue devaient toujours reposer sur le plain-chant, dans le rite latin les versets étaient entièrement libres. Sans être la première à en établir les rubriques, la Caeremoniale parisienne (1662) en fut néanmoins la plus importante. L’abbé Lebœuf a produit l’Antiphonaire de Paris (1737) et le Graduel de Paris (1738), qui contiennent un répertoire de plains-chants nouveaux et traditionnels. Ils restent le fondement des éditions successives jusqu’à la dernière parue en 1846. Ce nouveau style qualifié de «plain-chant musical», mélangeait des éléments traditionnels avec les conventions mélodiques, harmoniques et rythmiques modernes. Par exemple, la version originale de la célèbre messe d’Henry Dumont dans ce style (1699) comportait la note sensible ficta diésée et la notation mensuraliste. De telles mises en musique pouvaient n’avoir d’autre utilisation fonctionnelle que dans le rite pour lequel elles étaient écrites et, en conséquence, elles faisaient l’objet d’un répertoire publié assez réduit.
S’il existe des exemples d’un tel répertoire de la main de Fessy, Miné et, fait très révélateur, du mentor de jeunesse de Saint-Saëns, Boëly, ils sont relativement rares et ont tendance à être simplifiés à l’extrême. À l’exception notable de Boëly, les exemples publiés sont souvent de simples harmonisations du plain-chant avec le cantus firmus présenté à la voix inférieure. Les œuvres imprimées étaient clairement destinées aux instrumentistes les moins accomplis à une époque où la plupart des organistes improvisaient les leurs. Comme l’a noté Varcollier, l’organiste devait non seulement maîtriser son instrument sur le plan technique, mais avoir des compétences en harmonie et en contrepoint, ainsi que dans l’art d’improviser tout ce qu’il jouait. Le volume de musique qu’un organiste devait jouer sous le rite parisien nécessitait beaucoup d’improvisation. Nicolas Lebègue (c1631–1702) a calculé qu’à Saint-Merry, où Saint-Saëns allait par la suite occuper son premier poste, il devait jouer environ huit mille versets par an. La messe et l’office exigeaient que les versets à l’orgue soient joués en alternatim avec le plain-chant chanté par le chœur ainsi que divers morceaux de musique annexes. L’élévation, la communion, l’offertoire et la sortie requéraient tous de la musique pour orgue seul et, si le caractère de chaque contribution allait changer au fil du siècle, cette contrainte allait rester constante.
Outre l’obligation de présenter pour certains versets le chant sans modification, diverses traditions étaient observées comme prévoir une fugue pour le deuxième verset du Kyrie et des hymnes. À vêpres, l’organiste contribuait pour un verset après le premier, le troisième et le cinquième psaume et dans certaines paroisses après chaque psaume ainsi que dans l’hymne et le Magnificat. À la fin du service, l’organiste jouait le Benedicamus et devait souvent fournir l’Introït et un postlude. Si on chantait un Te Deum pour une circonstance importante ou une fête, l’organiste devait alors assurer seize versets pour ce seul Te Deum. La popularité du Te Deum, et en particulier de son Judex crederis constitutif, était très répandue en France à la fin du XVIIIe siècle et durant la première moitié du XIXe siècle mais, dans cette culture d’improvisation liturgique, il n’est guère surprenant qu’il en existe relativement peu d’exemples écrits.
Outre la nécessité pratique d’improviser propre aux organistes français, il y avait pour Saint-Saëns un second impératif encore plus important; pour lui, l’improvisation seule permettait d’employer toutes les ressources d’un grand instrument et de s’adapter personnellement à l’immense diversité des orgues; seule l’improvisation pouvait développer des facultés d’invention qui, sans elle, seraient restées lettre morte: «J’ai parlé de Lefébure-Wély, qui fut un merveilleux improvisateur et n’a laissé que des morceaux d’orgue insignifiants; et j’en pourrais citer, parmi nos contemporains, qui ne se révèlent entièrement que dans l’improvisation.» Et Saint-Saëns d’ajouter que la nécessité et le caractère exaltant de l’instrument accomplissent parfois ce que la préméditation ne peut réussir. On peut être surpris d’apprendre que l’Andante de sa Première Sonate pour piano et violoncelle et que la conclusion de sa Symphonie en ut mineur ont vu le jour aux claviers manuels de l’orgue.
L’accent mis sur l’improvisation et sa relation au plain-chant se reflètent dans les concours pour les postes d’organistes au XIXe siècle. La nomination d’Alexis Chauvet à Saint-Merry en 1864, pour laquelle Saint-Saëns faisait partie du jury, nécessitait l’exécution d’une improvisation ou d’une pièce préparée, d’une fugue avec pédalier (choisie par le candidat), d’un accompagnement de plain-chant et d’une improvisation sur un thème fourni par Saint-Saëns. De même, lorsque Widor a supervisé le choix d’un nouvel organiste à Saint-Denis en 1896, les candidats devaient accompagner le plain-chant, improviser une fugue, improviser une pièce symphonique et jouer une œuvre de Bach de mémoire. Pour la nomination de Vierne à Notre-Dame en 1900, sous la supervision de Dubois, ce programme fut élargi à l’accompagnement obligatoire du plain-chant, une fugue improvisée, une pièce libre improvisée et l’exécution de mémoire d’un chef-d’œuvre choisi par le jury parmi cinq pièces proposées par le candidat. De même, le concours d’orgue au Conservatoire de Paris était centré sur les capacités à improviser ce qui impliquait, en 1834, l’improvisation d’un accompagnement de plain-chant à quatre voix et une fugue improvisée à quatre voix. En 1851, le plain-chant devait être placé à la partie de soprano et de basse successivement. En fait, l’obligation de jouer une fugue de mémoire en 1852 a constitué la première exception à la règle de l’improvisation exclusive. Classé dans la même catégorie que l’harmonie et le contrepoint, l’orgue avait été considéré «principalement destiné à l’improvisation» par une commission du Conservatoire en 1848 et, jusqu’à ce que Widor prenne la barre en 1890, la majeure partie de l’enseignement de la semaine lui était consacrée. Cette pratique prévalait tellement que de nombreux observateurs de l’époque, notamment Danjou et Schmidt, ont tenu à faire remarquer qu’il n’y avait souvent aucune garantie qu’un organiste sache vraiment jouer!
Au fil des ans, dans le courant du XIXe siècle, le rite romain a été réintroduit progressivement dans les églises françaises et, peu après la première nomination de Saint-Saëns à Saint-Merry, il a été officiellement restauré à Paris. Le chapitre de Notre-Dame a accepté son utilisation en 1855 et l’a rendu obligatoire en 1874, un an avant qu’Orléans complète le processus national. Toutefois, la question du choix des plains-chants à restaurer restait entière. Dès 1811, les plains-chants utilisés dans le rite romain depuis le XVe siècle étaient critiqués comme une corruption de ceux que l’on connaissait d’après des sources manuscrites médiévales. Au début des années 1830, les bénédictins de Solesmes ont entrepris des réformes qui se sont concrétisées dans la publication de divers traités concernant la théorie et l’exécution du plain-chant comme le Traité théorique et pratique (1855) de Louis Niedermeyer et Joseph d’Ortigue, et le Cours complet de plain chant (1855–56) d’Adrien de La Fage. L’exécution du plain-chant et l’importance des styles antérieurs pour restaurer des normes de la musique d’église ont été souvent les préoccupations primordiales des diverses institutions qui ont vu le jour pour la promotion de la dite musique. Les principales étaient l’Institution royale de musique religieuse, fondée par Alexandre-Étienne Choron en 1825; l’École Niedermeyer, fondée par Louis Niedermeyer en 1853; l’École d’orgue, d’improvisation et de plain-chant, fondée par Gigout en 1885; et la Schola Cantorum, école de chant liturgique et de musique religieuse, fondée par Bordes, Guilmant et d’Indy en 1894.
C’est à l’École Niedermeyer que Saint-Saëns a occupé le seul poste officiel d’enseignant de toute sa vie: il y a été professeur de piano entre 1861 et 1865 et a eu comme élèves Gabriel Fauré, Eugène Gigout et Albert Périlhou, qui sont ensuite devenus ses amis de toujours. Mais c’est la Schola Cantorum qui peut être considérée comme le centre majeur de la réforme de la musique religieuse française au XIXe siècle. À l’origine, elle avait quatre objectifs principaux: améliorer les exécutions du plain-chant, restaurer le style de Palestrina à l’église, créer un répertoire moderne inspiré de celui-ci et améliorer la pertinence du répertoire de l’orgue par rapport à chacun des trois premiers. Tout en approuvant ce programme, Saint-Saëns s’est montré critique à l’égard de la Schola pour sa promotion du plain-chant et du style de Palestrina à l’exclusion de tout autre. Si, au moins pour l’offertoire, Saint-Saëns a presque toujours utilisé des thèmes de plain-chant pour ses improvisations liturgiques, il n’a jamais mâché ses mots à propos du plain-chant. S’avouant lui-même sceptique à propos des réformes de Solesmes, il a mis en doute ce qu’il considérait comme une tentative vaine pour redécouvrir la «pureté primitive» du chant. Néanmoins, il considérait que leur travail serait «sans doute un très grand bienfait» et, en fait, il était loin de s’opposer à l’utilisation de Palestrina ou du plain-chant mais, comme il le faisait si souvent, il défendait un certain équilibre. Ce qu’il mettait en doute, c’était le fait de se limiter aux premiers modèles à l’exclusion de la musique moderne et c’est la raison pour laquelle il a aussi critiqué le moto proprio, estimant que «chaque époque comprend la dévotion à sa manière». Néanmoins, il trouvait ce genre de restrictions «cent fois préférable à celui de platitudes dont on nous gratifie journellement au détriment de l’Art et sans profit pour personne».
Si le plain-chant n’était plus une obligation dans la musique d’orgue, il était encore utilisé pour l’ordonnancement de la liturgie, comme il l’avait été dans le rite gallican. En réalité, les changements effectués par la restauration concernaient plutôt le style que le rituel. L’importance du chant pour le caractère typiquement français dont parle Saint-Saëns se reflète dans la remarque de Guilmant: «Les organistes allemands ont composé des morceaux basés sur le chant des chorals, formant une littérature d’orgue particulièrement riche, que ne faisons-nous de même avec nos mélodies catholiques?»
En Italie et en Allemagne, ces efforts ont trouvé un équivalent dans le mouvement cécilien comme l’illustre la musique religieuse de Liszt et de Bruckner. Mais si le mouvement cécilien a cherché à remettre en vigueur l’utilisation du plain-chant, la tradition française avait été construite autour de ce dernier. À la fin du XIXe siècle, le plain-chant avait tellement imprégné la conscience musicale que Widor ne pouvait pas percevoir le côté sacré de la moindre musique d’orgue française sans le chant grégorien. Néanmoins, à partir des années 1870, l’orgue a commencé à bénéficier d’un nouveau statut comme instrument de concert en France et le répertoire semble étayer cette idée. Là où auparavant les exécutions hors de l’église s’étaient limitées dans une large mesure à des concerts inauguraux ou à des «auditions» dans des ateliers de facteurs d’orgues, l’amélioration du niveau comme de l’intégrité des organistes a commencé à attirer un nouvel auditoire pour cet instrument. Comme l’ont remarqué Saint-Saëns et Widor, les instruments symphoniques d’Aristide Cavaillé-Coll exigeaient un nouveau traitement et un nouveau répertoire. La tradition consistant à utiliser des thèmes de plain-chant à cet effet, qui a commencé dans les œuvres écrites d’Alkan, Lemmens, Gigout et Guilmant, et s’est poursuivie dans la musique de Tournemire, Dupré, Duruflé, Langlais et Messiaen jusqu’à ce jour. Faisant l’éloge du système d’accompagnement du plain-chant de Niedermeyer qui préservait le caractère modal de la mélodie, Saint-Saëns a donné lui-même un résumé approprié en expliquant que son système avait fait son chemin dans toute la France et même dépassé son objectif en nous montrant les possibilités d’introduire les modes anciens dans l’harmonie moderne, l’enrichissant ainsi d’une manière inattendue.
Le Prélude en fa majeur et les deux miniatures sans titre enregistrés ici ne subsistent que dans des sources manuscrites conservées à la Bibliothèque nationale. Ces trois œuvres ont été imprimées pour la première fois dans l’édition de 1991 de Depenheuer, où les miniatures ont pris le titre provisoire de Deux Versets. Bien qu’elles ne soient pas faites pour être ensemble, c’est une bonne description de la fonction comme du contenu de ces pièces. En tant qu’œuvres libres, elles pourraient être utilisées dans toute sorte de situations liturgiques et, même si ce sont des œuvres de jeunesse, elles sont sûrement caractéristiques des improvisations à petite échelle de Saint-Saëns. Elles comptent juste dix-sept mesures, avec un matériel thématique exploité avec art et douceur. Le Prélude, légèrement plus long, peut également être utilisé de cette façon, mais Depenheuer pense, à cause d’un trou dans le manuscrit, qu’à l’origine il était destiné à faire partie d’une œuvre plus étendue.
Saint-Saëns a écrit ses Sept Improvisations, op. 150, entre le 9 décembre 1916 et le 12 février 1917, alors qu’il se remettait d’une bronchite dans son lit; il les a créées à Marseille, Nice et Lyon environ un mois plus tard. À l’exception de la Fantaisie pour Orgue-Aeolien de 1906, ce sont ses premières œuvres pour orgue depuis les Trois Préludes et Fugues, op. 109, composés dix-huit ans plus tôt. Nous devons une éternelle reconnaissance à Périlhou, ami et ancien élève de Saint-Saëns à l’École Niedermeyer, pour avoir réveillé son intérêt pour l’orgue à la suite de ses désillusions et finalement de sa démission de la Madeleine en 1878. Après la nomination de Périlhou au poste d’organiste titulaire de Saint-Séverin au début de l’année 1891, Saint-Saëns avait l’habitude, accompagné de Fauré, de lui rendre visite à la tribune chaque dimanche où il était à Paris. Les trois amis jouaient chacun des improvisations durant l’office avant d’aller déjeuner, Saint-Saëns éblouissant souvent ses auditeurs par la magie de ses magnifiques improvisations, selon Félix Raugel. Louis Vierne a raconté combien Saint-Saëns aimait jouer l’instrument de Saint-Séverin et il est clair que sa contribution était jugée assez importante pour que, en novembre 1897, il reçoive le titre d’organiste honoraire.
Lorsqu’il a eu achevé les Improvisations et avant leur première exécution publique, Saint-Saëns est allé les jouer avec Périlhou sur l’orgue du Temple de l’Étoile. L’organiste de ce temple, Alexandre Cellier, s’est souvenu en 1954 combien Saint-Saëns avait apprécié jouer cet orgue en cette circonstance; il n’aurait probablement pas fait cette remarque entre 1878 et 1891. Il n’y aurait rien eu de surprenant à ce que l’opus 150 soit dédié à Périlhou, mais c’est en fait Gigout qui en fut le dédicataire. Saint-Saëns considérait Gigout, un autre de ses amis de l’École Niedermeyer, comme l’un des meilleurs improvisateurs de sa génération. Périlhou avait pris sa retraite en 1914 et comme Gigout était professeur d’orgue au Conservatoire de Paris depuis 1911, où il incluait des œuvres de Saint-Saëns au répertoire, il semble au moins possible que ce recueil ait été conçu pour avoir une valeur didactique. Trois des improvisations portent un titre et utilisent des thèmes de plain-chant: «Feria Pentecostes» repose sur le premier hymne de Laudes pour la Pentecôte, Beata nobis gaudia; «Pro martyribus» utilise trois phrases de l’offertoire de la messe pour un martyr, Gloria et honore coronasti eum; «Pro defunctis» cite l’offertoire du Requiem, Domine Jesu Christe. Il est intéressant de noter que, dans ces mouvements, Saint-Saëns colore son harmonie avec les modes mixolydien et éolien, alors que dans les pièces écrites librement son langage est plus contemporain. Depuis la Messe, op. 4, et les Six Duos, op. 8, il n’avait plus utilisé le plain-chant dans ses compositions écrites. La première pièce est aussi inhabituelle pour sa tonalité anhémitonique ambiguë.
Les Trois Préludes et Fugues, op. 109, achevés à Las Palmas en février 1898, sont dédiés respectivement à Fauré, Périlhou et Henri Dallier, qui était organiste à Saint-Eustache depuis 1879 et allait succéder à Fauré à la Madeleine en 1905. À la réception d’un exemplaire de la nouvelle œuvre publiée que Saint-Saëns lui avait envoyé en hommage, Fauré lui a répondu: «À mon retour [de Londres], j’ai trouvé de superbes Préludes et Fugues pour orgue que je ne saurai jamais jouer proprement et j’ai eu la grand joie de trouver mon nom en tête de l’un d’eux: je te remercie mille fois pour cette si agréable et flatteuse surprise!»
Saint-Saëns était célèbre pour ses fugues improvisées et l’op. 109 montre bien «le sujet … net, clair, incisif, le contresujet étonnant d’ingéniosité, les divertissements exquis de fantaisie et d’invention, les épisodes très imaginatifs et inventifs», dont parle Jean Huré. Saint-Saëns lui-même a raconté l’anecdote de la fiancée qui l’a consterné en lui demandant de ne pas jouer de fugues à son mariage car elles étaient trop sérieuses; et si l’op. 150 révèle toute une gamme de possibilités d’improvisation, l’op. 109 atteste également de la variété de ses fugues. La première et la troisième de l’op. 109, en ré mineur et ut majeur respectivement, sont certainement coulées dans le style spectaculaire qu’il recommandait pour l’instrument, mais avec des caractères variés. Toutefois, celle en sol majeur regorge du charme, de la grâce et de l’équilibre que l’on retrouve dans une si grande partie de sa musique. Vierne a loué ses œuvres pour leur forme et leur couleur, affirmant qu’elles devraient être «au répertoire de tous les organistes vraiment dignes de ce nom, tant pour leur style superbe que pour leur virtuosité d’exécution».
La contribution de Saint-Saëns à la culture nationale a été aussi importante que la rare combinaison de ses improvisations brillantes et de sa rigueur intellectuelle. Moins à la mode de nos jours qu’autrefois, une grande partie de sa musique attend encore toute la reconnaissance qu’elle mérite. Mais pour quiconque se donne la peine de l’écouter, elle semblera sûrement «si française» et «tellement nécessaire».
Andrew-John Smith © 2011
Français: Marie-Stella Pâris
POSITIF
Montre 18'
Viola da gamba 18'
Flûte douce 18'
Voix céleste 18'
Prestant 14'
Dulciana 14'
Octavin 12'
Trompette 18'
Bassoon et Hautbois 18'
Clairon 14'
GRAND ORGUE
Montre 16'
Violon-basse 16'
Montre 18'
Salicional 18'
Flûte harmonique 18'
Bourdon 18'
Prestant 14'
Quinte 13'
Doublette 12'
Plein jeu X
Trompette 18'
Cor anglais 18'
BOMBARDES
Sous-basse 16'
Basse 18'
Flûte harmonique 18'
Flûte traversière 18'
Flûte octaviante 14'
Octavin 12'
Bombarde 16'
Trompette harmonique 18'
Deuxième trompette 18'
Clairon 14'
RÉCIT EXPRESSIF
Flûte harmonique 18'
Bourdon 18'
Flûte octaviante 14'
Octavin 12'
Trompette harmonique 18'
Musette 18'
Voix humaine 18'
Clairon 14'
PÉDALE
Quintaton 32'
Contre-basse 16'
Violoncelle 18'
Grosse flûte 18'
Bombarde 16'
Basson 16'
Trompette 18'
Clairon 14'
Hyperion Records Ltd ©


